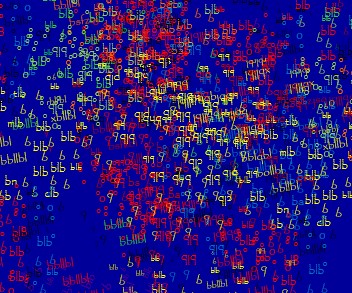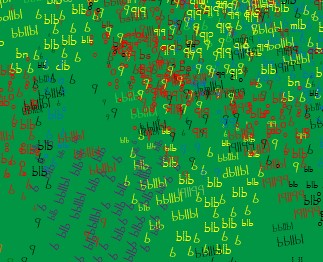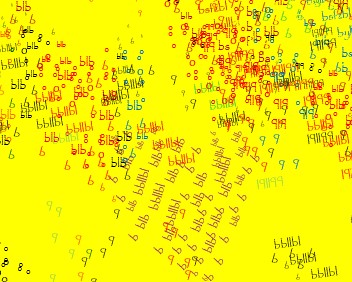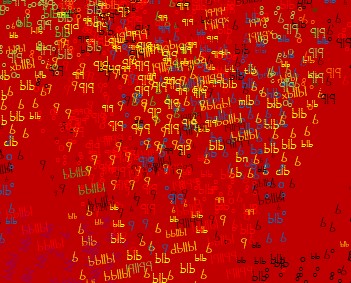Jerry Stahl, dont 13e Note [RIP] publia autrefois Mémoire des Ténèbres, confiait ceci au journaliste de Libération, Lelo Jimmy Batista [Libé du 21 janvier 2023] : « Il y a une super réplique à la fin de Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller, où Happy et Biff sont devant le cercueil de leur père. Happy dit : « Il savait tout faire… » et Biff ajoute « sauf choisir ses rêves. » Vouloir être écrivain, a fortiori un écrivain comme moi, au XXIe siècle, c’est très mal choisir ses rêves. Mais je peux travailler pour le cinéma, la télé… Ça me permet de sortir un livre ici et là ».
Je dois bien avouer que je tournais autour de ce « truc » – un pressentiment plus qu’une idée – depuis des mois déjà, sans pouvoir le définir, ni même le cerner. Je vous le dis d’emblée : il n’y a pas de cadavre. Pas de preuves, pas de buzz, pas de danse de l’ours, et tout est d’une certaine manière fantomatique.
Je me suis d’ailleurs longtemps demandé si ce sentiment n’était pas nourri par une aigreur naissante. À force d’introspection, de doute et de questionnements multiples, il m’est permis de vous répondre : il n’en est rien. Pas d’aigreur ni de bile égrotante, juste la littérature à l’estomac.
Quelques signes épars (que j’ai accumulés comme je collectionne les refus des maisons d’éditions), une certitude intérieure – mais peut-elle être la fondation d’une analyse ? – et la lecture d’un ouvrage, Le Fétiche et la Plume de Hélène Ling et Inès Salas (éditions Rivages), m’ont permis de donner enfin corps à ce sentiment diffus, une formulation à mon questionnement : la littérature tendrait-elle à disparaître, à s’effacer progressivement, dans un effet de fading quasi silencieux et interminable ?
Bien d’entre vous se récrieront, mais non, allez, ce n’est qu’un petit coup de déprime, on lit, encore, et pas qu’un peu, plutôt deux fois qu’une même, regardez les chiffres de vente, le livre ne s’est jamais aussi bien porté !
Je vous rétorquerai d’abord que, comme pour le chômage, on truque les chiffres. Dans les statistiques des ventes de livres de littérature, Faulkner et Beckett sont comptabilisés au même titre que les romans feel-good. Les rangeriez-vous – vraiment – dans la même catégorie ?
Vous pourriez en retour avancer que ce type de constat n’est pas nouveau – toute modestie gardée, Julien Gracq et Eric Naulleau par exemple l’ont fait avant moi – et que régulièrement, de la même manière que l’on déplore la déliquescence de la langue française, on se lamente sur la baisse du niveau, la décadence de la culture et sur le fait que tout-fout-l’camp, ma bonne dame, avec, en horizon lointain et en toile de fond, l’ersatz d’idée (réflexe pavlovien, mécanisme neuronal ?) que, de toute façon, c’était mieux avant.
Ils ont la mémoire courte.
Il ne s’agit pas, pour ma part, de clamer que c’était mieux « avant » (avant quoi d’ailleurs ?). Je ne nourris aucune nostalgie. Je ne vis ni sur des regrets ni sur le temps passé. J’ai même tendance à couper les ponts et à toujours regarder devant (parce que comme tout écrivain, la meilleure œuvre est celle à venir). Je cherche au milieu de cette nostalgie, ce qui s’est vraiment perdu. Non pas ce qui ne reviendra pas, mais ce qui en qualité, en synchronie, a disparu. Et ce qui est apparu en lieu et place.
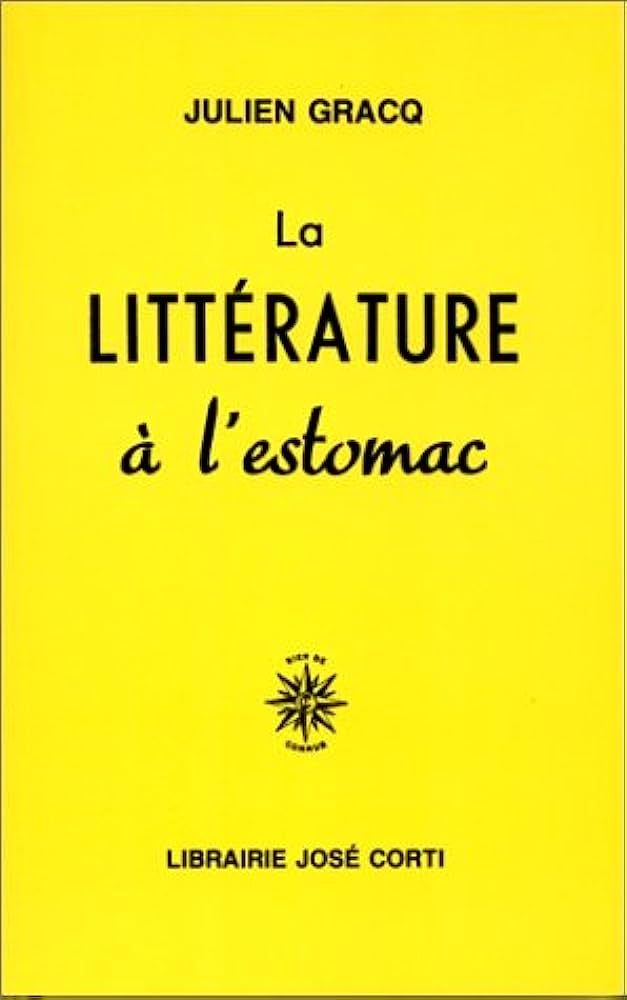

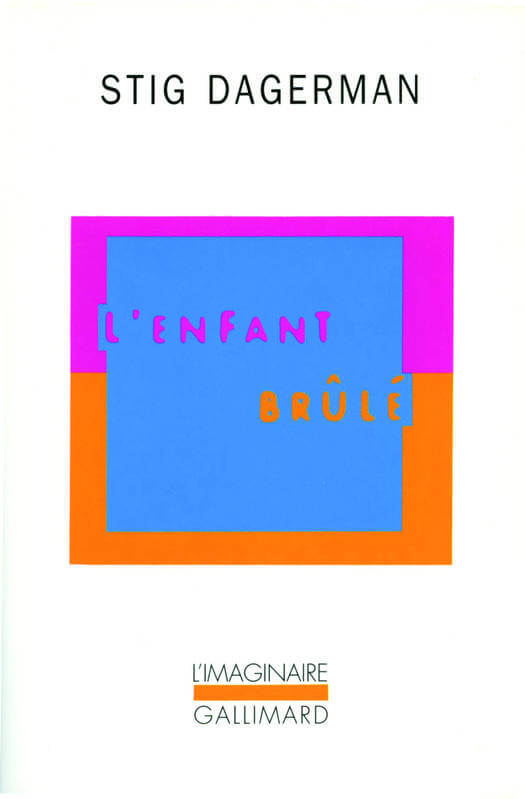


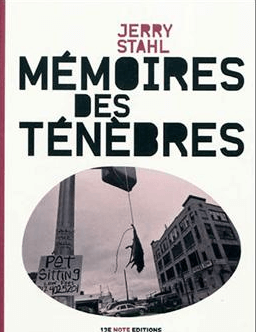
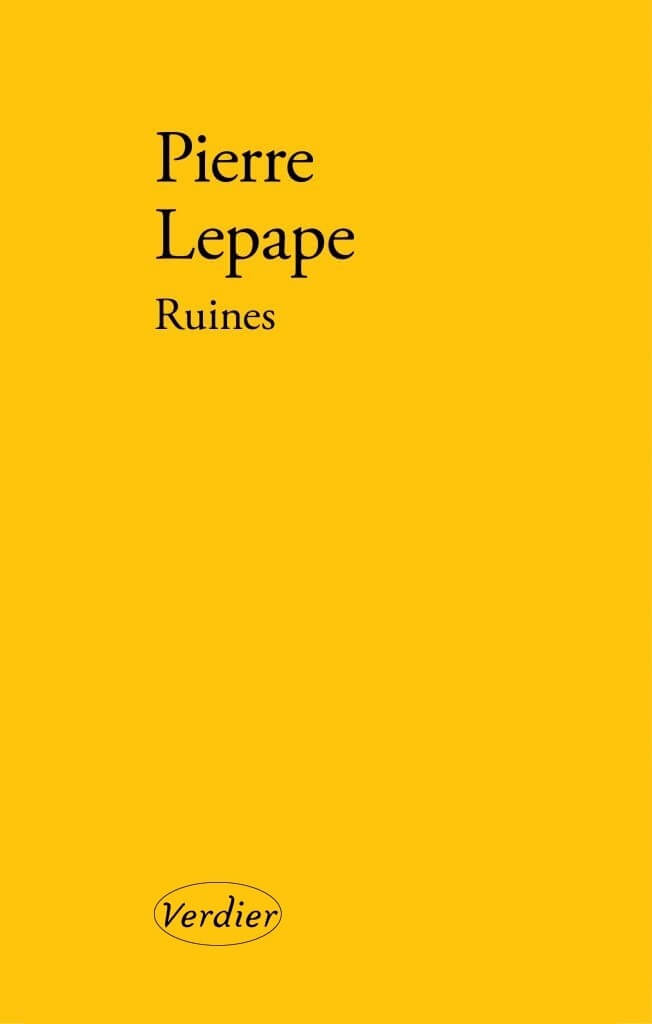

Pourquoi donc la littérature aurait-t-elle perdu de son aura ?
Parce qu’elle demande un apprentissage ?
Parce que le temps imparti à la lecture non morcelée (une plage de temps d’une heure) s’est amenuisé ?
Parce que c’est une activité où on ne peut pas regarder les notifications de son portable toutes les trois minutes (on ne consomme pas, on se laisse prendre par le flux d’un texte, par la respiration d’une écriture, par ses méandres et ses différences de rythme) ?
Parce que le silence est généralement le milieu sonore le plus propice à la lecture et qu’il fait partie des espèces en voie de disparition ?
Parce qu’on a toujours autre chose à faire que de lire – les to-do list, en perpétuelle transformation, étant par essence inachevables ?
Un peu de tout ça, avec en prime, le fait que de tous les nombreux media culturels, il est le plus exigeant. Pour survivre, il est devenu un media de masse, dans lequel s’est perdue la croyance littéraire. Il y a encore des livres mais la littérature a déserté nos existences (pourquoi y aurait-il un « Printemps de la poésie » sinon pour en faire la commémoration ?).
Bref : Julien Gracq, Louis-Ferdinand Céline, Marcel Proust ne seraient plus aujourd’hui publier. Trop long, trop dense, trop écrit. On veut de la langue qui s’avale sans mâcher, de la langue qui se donne comme une fille facile, qui se consomme, pas une langue où il est nécessaire de se laisser au vestiaire avant d’entrer, de se délester de ses propres encombrements – être disponible – pour se couler dans sa respiration et se laisser emporter par leur ligne de fuite lente mais certaine.
À cette nouvelle économie de l’attention, au morcellement des plages de temps disponibles et au formatage de l’écriture s’ajoute l’hyper-concentration éditoriale, qui a eu des effets pervers sur le contenu. De la même manière que le christianisme existe toujours, alors que Dieu est mort depuis belle lurette, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de bons textes, bien écrits, qui ne tournent pas. Cela signifie que la marge de liberté et d’originalité s’amenuise, progressivement et toujours un peu plus. Au sein d’un système éditorial à bout de souffle, la fracture se creuse d’année en année : d’un côté, une production très intellectuelle, au tirage confidentiel – récit poli et raffiné, où la narration se perd dans les méandres d’une écriture ciselée (et dont Michon serait le plus illustre représentant) ; de l’autre une production grand public, très marketée, où certains auteurs semblent fabriqués (à la limite d’être des hommes de paille, des façades), et interchangeables. Au milieu, des produits divertissants, dont on n’a pas à rougir, mais qui, justement, ne font que nous divertir. Il y a bien entendu des exceptions qui viennent dézinguer ce sentiment. Il n’empêche que la littérature est désormais un produit culturel. Or, la valeur intrinsèque d’un produit est d’optimiser son rendement. Il doit de ce fait plaire au plus grand nombre. Il faut donc des sujets à la mode, une écriture capable d’être bue par le plus grand nombre, des contenus qui soient transférables et adaptables sur d’autres supports, des écrivains enfin dont une des tâches principales est de peaufiner leur image et leur storytelling. Tout ceci n’a cependant pour origine qu’un seul phénomène. De la même manière que le dérèglement climatique découle directement de notre mode de production et de consommation, la métamorphose du paysage éditorial vient pour l’essentiel de sa marchandisation, plus généralement de la marchandisation du monde. La logique de standardisation et de rentabilité est à l’œuvre partout (dans le cinéma par exemple, avant lui sur le marché de l’art) : pourquoi la littérature y aurait-elle échappé ?
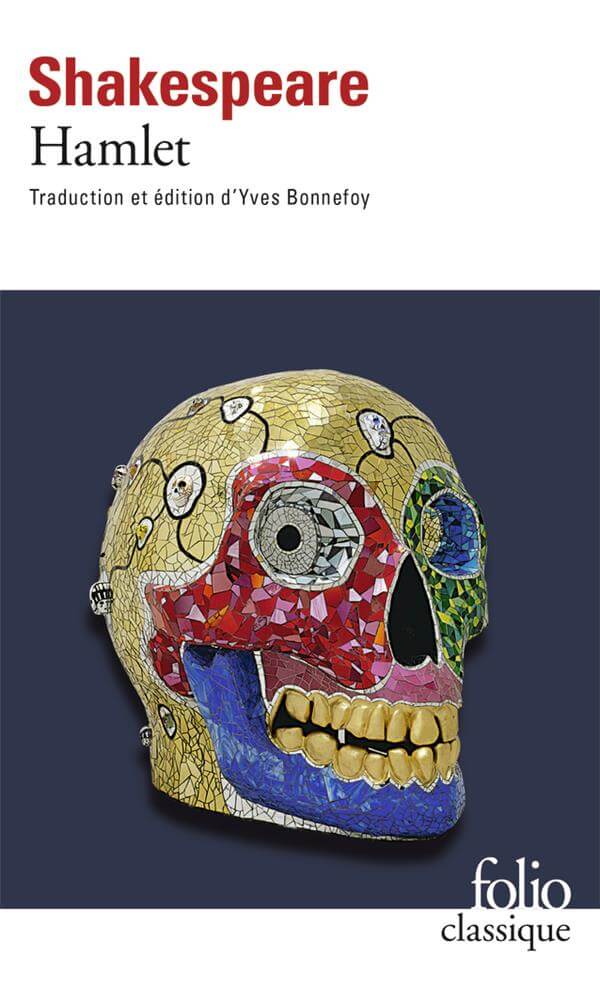
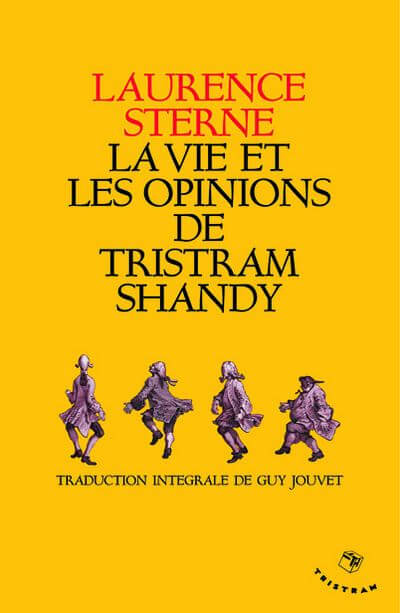
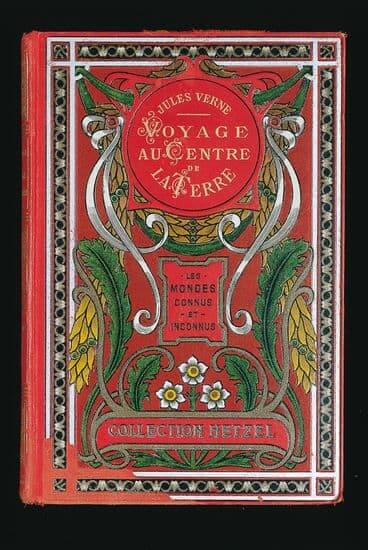
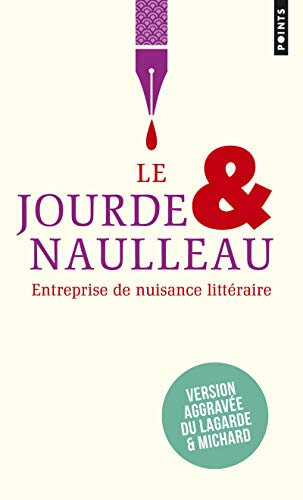

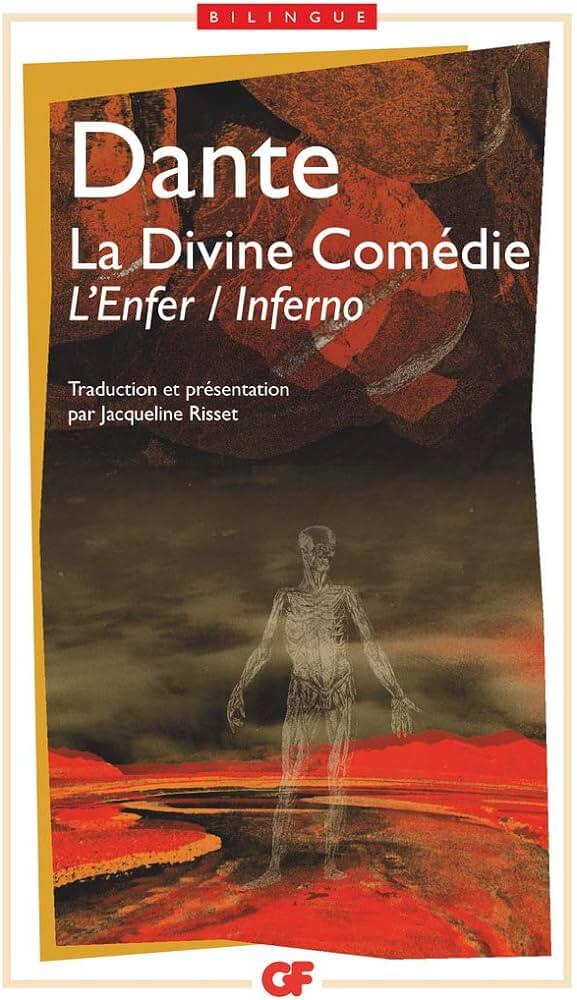
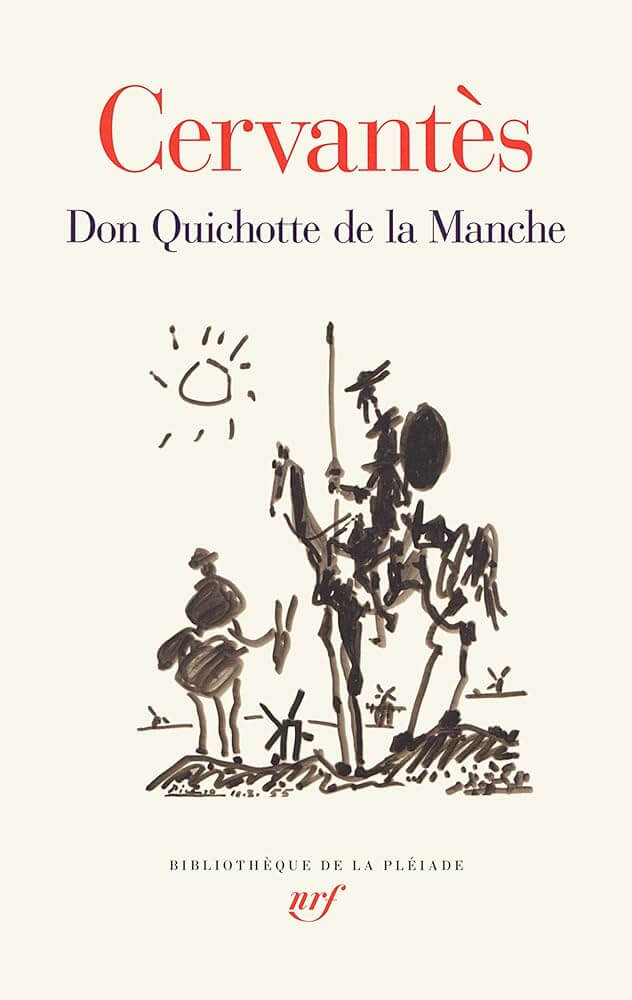
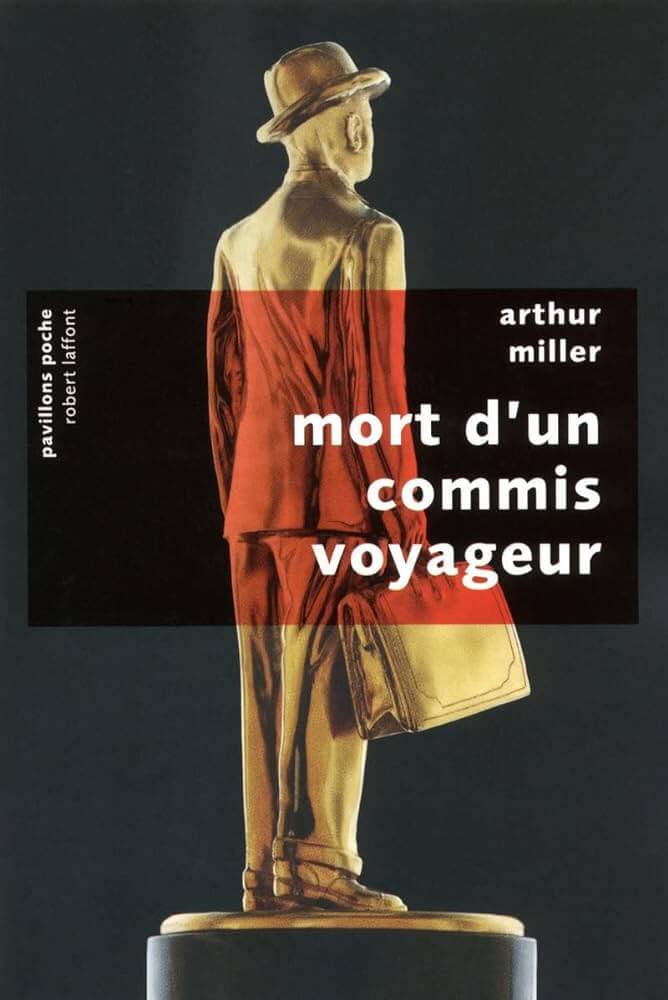
J’ai commencé à écrire, il y a plus de vingt ans maintenant. Dans ce laps de temps, celui d’une génération, beaucoup de choses ont changé.
Le paysage éditorial tout d’abord. Au-delà de l’hyper-concentration et de la standardisation évoquées plus haut, le système est arrivé à bout de souffle – le signe le plus probant en est l’annonce des éditions Gallimard, en avril 2021, sur son site internet, demandant aux écrivains de surseoir à l’envoi des manuscrits. On produit trop. Des milliers de manuscrits tournent. Dans cette cohue, on a le sentiment de se trouver dans le métro aux heures de pointe, flanqué de la désagréable impression d’être noyé dans la masse, dans la quasi impossibilité de se faire remarquer. Le nombre de livres publiés et de ceux finissant au pilon (20 à 25% de la production annuelle…, recyclée en papier hygiénique et produit d’emballage) s’est également accru.
L’image de l’écrivain ensuite. Flaubert suant à sa table de travail, donnant de la voix dans son gueuloir était encore l’archétype en vogue à l’aube du millénaire. J’avais quant à moi l’image du Malone de Beckett travaillant dans une pièce close, glissant de temps à autre quelques feuillets sous la porte. Flaubert et Beckett ne sont plus aujourd’hui que des ancêtres lointains, dont on ne revendique plus l’ascendance, et qu’on lit peu.
La dilution de la littérature dans le marché a aussi eu pour effet de diluer sa valeur réelle. Le talent est encore moins qu’avant un des critères de « recrutement ». L’écrivain, qui n’est plus un ermite mais un humain hyperconnecté, n’est plus repéré pour son talent mais pour son profil marketing (et sa capacité à vendre : il est un produit) ; il doit cocher toutes les cases – proposer un sujet en vogue, être dans la ligne éditoriale, avoir un style formaté. Il doit de surcroît être présent, faire du bruit, s’agiter sur les réseaux sociaux, montrer qu’il existe ; être lisible, sympathique, présentable, vendre sa personne plus que son œuvre, sa propre histoire plus que celle de ses personnages (et quand son histoire et son œuvre coïncident, c’est encore mieux), se mettre en scène à la manière d’un phénomène, si bien que tout ce battage autour de l’œuvre finit par recouvrir l’œuvre elle-même (peu importe : elle a contribué à faire tourner la machine médiatique, c’est l’essentiel). C’est pourquoi les maisons d’édition hésitent aujourd’hui à recruter un auteur qui n’aurait pas un minimum de visibilité. Elles ne lisent plus – mais parcourent – les manuscrits. Elles ne lisent plus que les lettres d’accompagnement qui doivent d’ailleurs être rédigées comme des argumentaires de vente (je le tiens d’une éditrice, qui m’a prodigué ce – judicieux – conseil). L’écrivain n’est, en outre, plus l’homme d’une œuvre mais celui d’un livre, qu’il devra en somme recommencer, ad vitam aeternam ou presque, pour être sûr de ne pas décevoir son lectorat, et ne pas le perdre. On n’innove plus, on produit, on reproduit. Quant au statut d’auteur, il n’existe plus (s’il a jamais existé). Nous travaillons comme des bénévoles.
Parlons enfin de perte symbolique. Comme on croyait autrefois à la sagesse (même les vieux n’y croient plus et ne se coulent plus dans cet habit de sage : voilà une raison de plus d’être encore plus cons), on croyait aussi à la littérature. Faire ses humanités avait un sens (et nos références étaient encore celles du monde judéo-chrétien). On a assisté dans ces deux dernières décennies à un désinvestissement symbolique massif de la culture classique. Les technocrates ne s’en nourrissent plus. La valeur symbolique de la littérature a chuté. C’est désormais un champ dominé par les médias, la rentabilité et le divertissement, où le présent est privilégié. Dans ce présent sans mémoire, qui ne soucie plus d’innover, l’histoire littéraire – qui s’est arrêtée au Nouveau roman – n’a plus voix au chapitre. Dans cette modification du paysage, les classiques sont passés à la trappe. Ils ne sont plus cités dans les émissions littéraires, ne sont plus guère étudiés que dans les institutions scolaires (et encore), uniquement au lycée ou à l’université. Qui a pour projet de passer ses vacances à lire Musil ou Proust ?
De fait, dans le même temps, la littérature a perdu son statut de référent premier et la primeur d’expliquer le monde, au profit des médias. Diluée, noyée au milieu de flots répétés de divertissements de tout poil, la littérature, qui est sans doute la moins bien armée, peine à surnager. Alors, elle s’accroche, aux histoires qui filent sur la bande passante, à toutes les histoires qu’on lui donne en pâture, surtout celles tirées de faits réels (le « tiré de faits réels » semble être un multiplicateur, une sorte de sésame, analogue au « vu à la TV » dans d’autres secteurs). Elle s’y accroche, à ce réel, comme une moule à son rocher, croyant encore expliquer le monde. C’est une forme de diktat, comme si toute histoire pour être crédible devait être vraie, comme si une histoire devait coller à la réalité pour gagner en concrétion et en véracité. J’y vois une condamnation implicite de l’imaginaire et de cette possibilité qu’ont les mots de recréer le réel. Moi qui écris pour être ce que je ne suis pas, moi qui vis l’écriture comme une fuite (fuir les certitudes, l’établi, l’état civil, et entrer dans une zone grise de soi), je le vis comme une assignation à résidence.
Fin de la digression. Revenons à nos histoires. Car nous voulons des histoires. Des histoires comme les enfants. Des histoires pour tout, les personnes, les marques, les animaux, les villes, les objets (surtout de luxe), et chacun raconte la sienne, sur le réseau qu’il affectionne. La pandémie a, semble-t-il, accéléré ce processus. Le confinement a produit un effet cocon assez pervers. Chacun veut des histoires dans lesquelles il pourra s’installer confortablement et durablement (d’où le succès des séries, l’image en soi, comme la langue pour elle-même, important peu).
Ce qui se joue là est le démantèlement de la littérature dans sa spécificité. Le fait de simplement raconter une histoire en fait un contenu adaptable et transférable. De là à publier des livres qui n’honorent que de tels contenus, il n’y avait qu’un pas, qui a été franchi, pour arriver enfin à une standardisation aboutie des produits et des pratiques littéraires.
C’est sur le même type d’analyse, appliquée au cinéma, que Nanni Moretti a construit son dernier film – qui a des allures de testament -, Vers un avenir radieux. Il pointe ce qui a disparu. D’un côté comme de l’autre, ce n’est pas une mort mais un assassinat déguisé, sous la houlette du divertissement. Une pensée divertissante : voilà un oxymore. Divertissement généralisé : ne plus penser. Voilà le but à terme. Mais le processus est souterrain, s’opère par glissement progressif, comme une gentrification ; il est quasi imperceptible, comme le vieillissement d’un visage, sinon par quelques signes épars, qui cependant, ne trompent pas. Imperceptible, mais l’image que nous reflète les miroirs est méconnaissable. Peu importe. Le nom reste. Et on produit les illusions ou les simulacres nécessaires pour que tout continue. C’est le chiffre qui compte. The show must go on. Le roi est nu depuis longtemps mais nous faisons semblant et nous nous taisons, à défaut de fermer les yeux.
À l’ombre de ce système, en marge, en circuits courts, de petits éditeurs continuent à fabriquer des écrins pour des textes remarquables. Ils circulent comme jadis sous le manteau, génèrent du bouche à oreille. Tablez sur ces éditeurs, achetez leurs livres, passez-les, faites de la résistance, de la même manière que… je ne sais pas… que vous allez au cinéma plutôt que de vous abonner à Netflix ?
Quant à moi, l’attente d’une légitimité éditoriale a fini par me déserter. J’écris pour les lucioles. Cette activité structure ma vie – c’est toujours mieux que d’être happé par les réseaux, ou d’avoir le sentiment que plus rien n’a de sens – et m’équilibre. Je trouve ici et là – plus ici que là – quelques lecteurs : merci à vous.
Je finirai cet article de la même manière que je l’ai commencé, par les paroles d’un écrivain. Il y a quelques mois, Jean-Marie-Gustave Le Clézio confiait au Monde : « Récemment, je parlais à un éditeur en Corée qui m’a demandé à brûle-pourpoint : « Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes un des derniers ? » Un des derniers quoi ? Il m’a dit : « Un des derniers écrivains qui écrivent et qui ne fassent rien d’autre. » Normalement, c’est impossible. Il a ajouté : « La littérature, c’est fini, fini. ». Ça m’a un peu déprimé. Alors c’est bien qu’ici, en France, on continue à avoir confiance en la littérature. »