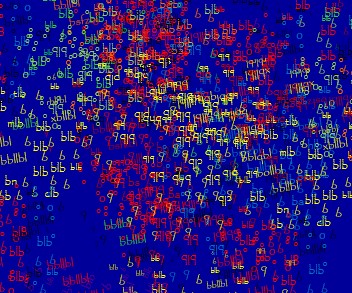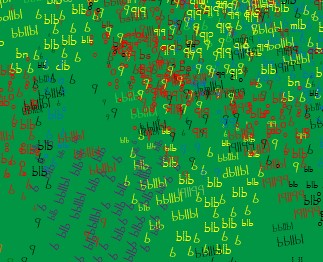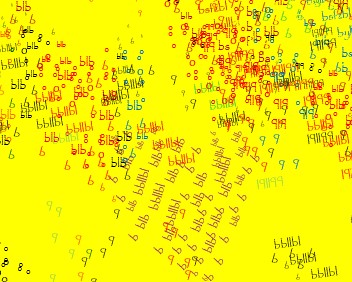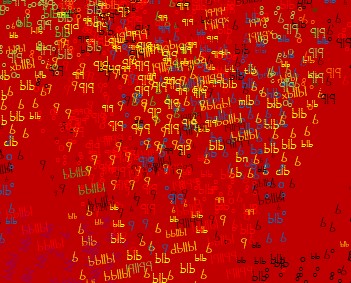Je ne vous dirais que deux ou trois choses de lui. Il ne quitta presque jamais Rutherford, New Jersey (où il est né), contrairement à son ami d’adolescence, Ezra Pound. Il pratiqua toute son existence le métier de pédiatre et celui, artisanal, de poète – deux vocations qu’il parvint à faire coexister. Il reste pour moi la quintessence de la poésie sensible, simple et néanmoins extraordinairement inventive, celle qui refuse l’hermétisme et la prétention. Celle qui, envers et contre tout, est connectée au monde, à sa prodigieuse diversité, et à la vie, jusque dans son quotidien le plus banal. Même dans ses expérimentations prosodiques, Williams est, toute sa vie, restée à hauteur d’homme. Son œuvre ne fut reconnue que tardivement, mais eut une postérité prolifique. De nombreux poètes américains – ceux du Black Mountain College notamment (Charles Olson, Robert Duncan) – ont dit l’importance et l’influence de son œuvre. Il publia son premier recueil à l’aube des années 20, fit partie dans les années 30 de l’aventure objectiviste (en compagnie de George Oppen et Louis Zukofsky), publia son opus majeur, Paterson, en 1946 (qui reste un des jalons majeurs de la poésie nord-américaine) et jamais ne cessa d’écrire. Son œuvre compte une trentaine d’ouvrages. Certains ont été traduits ou retraduits ces dernières années, notamment par Yves Di Manno (Paterson, aux éditions José Corti) et par Valérie Rouzeau (aux éditions Unes). Il inspira enfin Jim Jarmusch pour son film Paterson.



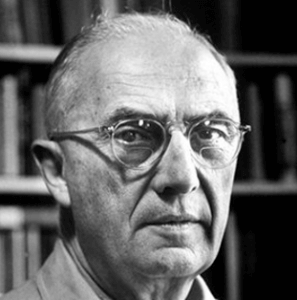

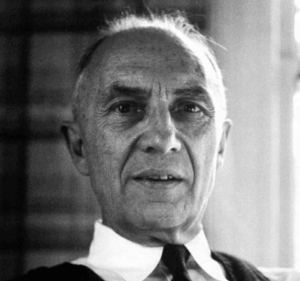


à quoi je pense là ?
à cette vieille
salope
d’Eliot
qui autrefois
pourrit le printemps
&
à
toi
mon cher
vieux
“Bull” oui je pense à toi
la rigueur de la beauté c’est un coup de silex
à la mesure du monde il faut de la cadence et de la souplesse dans cette cadence
tout se joue à l’oreille
histoire d’équilibre interne
et sur la page aussi la disposition des lettres
la beauté
ppffff
nous l’avons baisée
et rebaisée
sans lui conter
levrette disaient-ils
t’as vu la gueule qu’elle
se paie
comment inventer le nouveau les marges sont tellement
larges
la rime
honnie
ne reste qu’un squelette qui ne danse plus
sur la page
même quand il cherche l’espace
la rigueur la vigueur
voilà tout ni l’écho lointain d’un rêve ni l’idée sans chair
ni la chair sans voyage
vie densité quelque chose qui ne ressemble à rien
énergie peut-être douce et folle énergie feu de joie qui monte haut dans le ciel et coure
devant toi
mon cher vieux-“Bull”,
je te revois
griffonnant fiévreusement entre deux patients
dans ta vieille Ford
garée dans une allée de cette ville de banlieue
que tu n’as pas quittée
pour l’Europe
New-York
ou la Californie
l’homme d’un lieu
ta peau a le
grain américain
du vieux-barde
sur ton carnet
quelques mots
qui t’ont éraflé traversé tourmenté
pense-bêtes
un élan
suspendu
auquel tu redonnes
vie
le soir
lâchant ces bêtes folles
sur la page
mon cher vieux-“Bull”
il y a aujourd’hui cinquante ans que tu es mort je m’en souviens comme si c’était hier
j’aime chez toi
l’idée que l’imagination
porte le réel ne le fuis pas
la gentiane
et la carotte sauvage
l’herbe sèche la grive
et le pivert
tacheté de rouge
le nigelle aussi
&
le feu en dedans mis sous l’éteignoir
de ton quotidien
modération
tu côtoyais la vie la mort
dans ce qu’elles ont de premier
la mise au monde
de l’autre côté l’échappée belle
comment des théories auraient-elles pu se défendre
de telles proximités ?
une nouvelle mesure
pas de prophétie
tu n’as pas les pieds plats
et le lombric épouse
la courbure du monde
pas de doute c’est le nôtre on ne peut plus
familier
le clochard du coin
une prune dans un frigo
une brouette dans un jardin
&
autre
chose
le regard clarifié
as-tu lu Saigyô ? Ryôkan ? Bashô ?

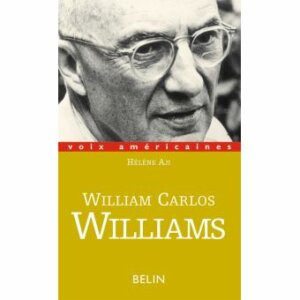
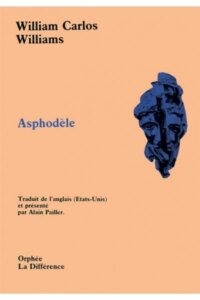
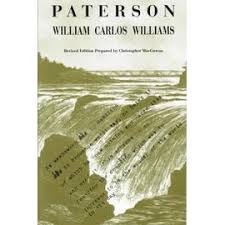
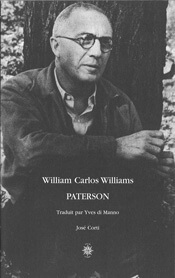
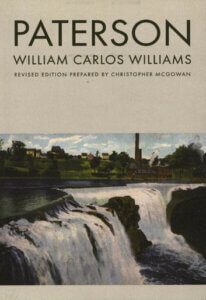
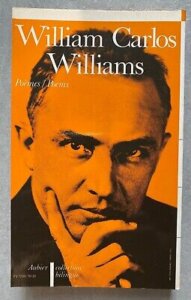
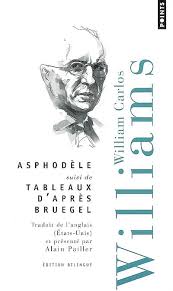
mon cher vieux-“Bull”,
tu ne brandis pas
tes poèmes
comme des armes
des leçons des mystères
ou d’autres leur arrogance
tu m’as transmis
une posture
celle de ne pas refuser mépriser
mon innocence
je ne suis plus dupe
des non-dupes
elle n’est plus cette coquille vide
pourrissant dans une décharge
depuis des lustres
vivre sans remparts
les Puritains
disais-tu
ont dû se fermer au vaste monde
n’ayant en eux aucune curiosité aucun émerveillement face au Nouveau Monde
ils ne savaient que garder leurs yeux bandés
leur langue bien rangée dans leur bouche
leurs oreilles assourdies
par la monotonie des hymnes
et leur corps confinés
dans des habits étroits
je me souviens aussi
du 9 Ridge Road, Rutherford
de Flossie
et de la fraîcheur
de l’asphodèle
qui n’a rien d’une fleur bleue
de tes Korégraphies expérimentales
de ton admiration pour Soupault quelqu’un de très drôle vraiment drôle
et de ta traduction des Dernières Nuits
de Paris
de l’Anthologie Objectiviste publié aux éditions TO en 1932
du chien de Paterson qui erre la truffe au vent
du noyer blanc et du cornouiller
des bois de Kipps
de ta conception de la mémoire
vue comme une manière
d’accomplissement
une manière de renaissance
et même
une initiation
premier usage
assumé –
division en trois pieds variable
dessinant sur la page
des degrés –
du vers triadique
du moineau trémoussant
ses ailes
dans la poussière
de ta différence et de ta solitude
incommunicado
de tes sens exacerbés
sans cesse
en éveil
tu étais sans doute
sur-dou-é
de ton premier souvenir, en 1888
grelottant seul
dans le jardin enneigé
& de ta mère intransigeante
de H.D.
et d’Ezra Pound
te lisant ses premiers poèmes
dans ta chambre d’étudiant
à Phillie, Pennsylvanie
&
de ta colère
1924 après dada table-rase
à la sortie de The Waste Land
cultivé académique élitiste
chez toi
c’est la vie
toujours nouvelle et dépourvue de règles
qui prolifère
une vie que tu allais chercher
en dehors des bibliothèques
dans la rue
dans la bouche des mères polonaises
parce que rien n’est séparé
de ce qui te distingue
d’Ezra Pound
au-delà de cette morgue érudite
les Cantos ont fait long feu
la culture qui les porte s’éloigne lentement de nous
comme la barque qui dérive vers Avalon s’enfonce dans la brume
pour devenir
imperceptible
tes poèmes poussent encore
leurs surgeons
au milieu des décombres
voici cinquante ans qu’on ne cesse de découvrir ton œuvre
qui ne se donne pas
d’un bloc
de nouvelles traductions
la mesure de la Musique du désert
ne redouble pas
celle du Printemps
il m’a fallu du temps pour saisir les fils
qui traversent tes livres
pas de méthode arrêtée
pas de champs clos
pas de genre interdit
une œuvre au désir constant
d’occasions aussi
de tocades
de tentatives
parfois ratées
que l’on peine
à coudre les unes aux autres
c’est là où la vie t’avait mené
tu ne fus jamais très soucieux
de postérité
tu cherchais
tu as affiné tes choix
mon cher vieux-“Bull”
ne te fâche pas
si je te dis
que
tu étais
un bricoleur
hors dogme
faisant feu de tout bois
osant
expérimentant
décloisonnant
empirisme jamais nommé
qui irrigua toute ta vie
oui la forme n’est jamais
qu’une extension du contenu
des idées incarnées
dans des objets poétiques
la vivacité de la sensation
et l’objectivité des choses
écrivait Octavio Paz
qui cisela une
poésie du concret
le vide et ce qui arrive
voix claire
audace prosodique
intelligence du réel
intelligence du cœur aussi
& cette langue impure
qui prenait la couleur
de l’instable
marchait de traviole
furent des porte-voix
qui ont mené tes chants
jusqu’à moi
dans le clair-obscur
je ne cherchais pas
l’aura d’un maître
ta postérité fut tardive
hasardeuse
ta descendance prolifique
pas de disciples
des reconnaissances
mon cher vieux
William Carlos
Williams
quel drôle de nom
tu portais
il y a
cinquante ans
que tu es mort
aujourd’hui
quatre mars deux mille treize
en signe
de respect
et d’affection
face contre terre
je m’incline
devant toi.
Montreuil – 4 mars 2013
post-scriptum –
au fait je les ai goûtées ces prunes,
elles étaient chaudes et sures – le prunier,
le jardinier a oublié de le tailler l’hiver dernier.