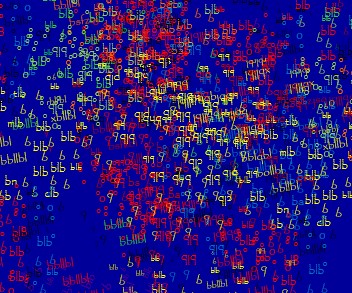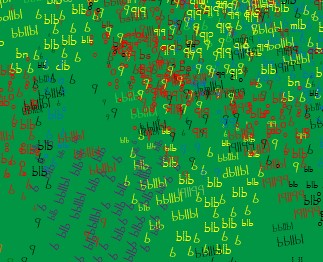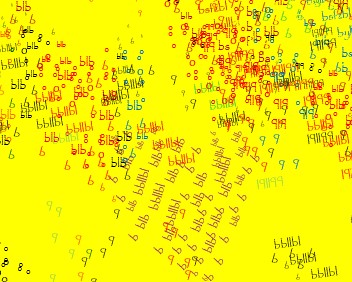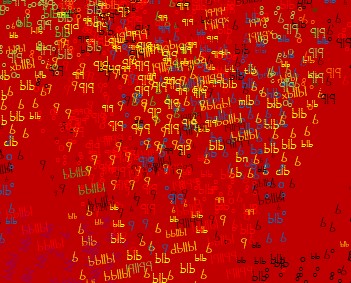Vous en avez marre de la routine et du quotidien ? Vous cherchez le grand vertige ? Vous voulez changer d’air, voir du pays, en somme vous réinventer, vous mettre en vacances de vous-même, entrer en lévitation ?
Eh bien, lisez Fils !
Avec Fils, vous apprendrez à tutoyer les gratte-ciels, à regarder l’abîme qui s’ouvre sous vos pieds sans sourciller (et dans le blanc des yeux), à marcher sur un fil mais pas sur le fil du rasoir. Bref, vous serez pris de vertige, celui enivrant que connait le funambule, celui excitant que côtoie le mangeur de nuages.
Avec Fils, vous visiterez également l’URSS de Staline, vous traverserez l’Allemagne, détruite et en feu, du nazisme moribond, et vous déambulerez sur la plage de Dunkerque avant de rêvasser dans la gare d’Anvers.
Avec Fils, vous suivrez aussi pas à pas le fil d’une enquête, car bien entendu, derrière cette histoire de funambule se trame aussi une histoire de filiation – ça ne s’appelle pas Fils pour rien.
Vous reprendrez enfin le fil de vos rêves, celui peut-être aussi des métaphores qui vous travaillent, des questions que vous avez laissées en suspens et qui vous rongent la charpente (d’ailleurs, à propos de charpente, une surprise vous attendra).
Avec Fils, apprenez à tourner la page. A regarder l’horizon comme une ligne émaillée de promesses.
Fils : la purge pour moins que rien. La grande aventure à portée de main.
Fin de l’intermède publicitaire.








Mais encore ?
Plus prosaïquement (car, toute poésie funambule gardée, c’est bien de prose qu’il s’agit), c’est l’histoire d’un homme qui change de travail, de compagne, de maison, d’histoire familiale même, bref qui porté par le cours des événements change de vie, apprenant peut-être par la même occasion à être un peu moins con.
Ce roman, dans lequel j’ai tenté d’injecter ce grain de folie qui affole jusqu’aux plus belles mécaniques, je l’ai souhaité tout à la fois grave et frivole, sur le fond et sur la forme, et même un peu loufoque ; perché en l’occurrence conviendrait mieux puisqu’il y est avant tout question de l’art délicat et passionné des funambules. Mais aussi de rencontre amoureuse, de Nuit debout, de mémoire familiale et de transmission, d’une mémoire qui tout à la fois, dans le même mouvement, se délite et se reconstruit.
Au fil de sa quête, qui sera pour lui l’occasion d’une incursion dans certaines périodes sombres de l’histoire européenne, le narrateur (un de mes doubles à n’en pas douter, ce texte, tout en étant fictionnel, a une large part autobiographique) envisage peu à peu d’un autre œil ses aînés, les découvrant différents de ce qu’il croyait.








Extrait :
La neige, le ciel bleu, le silence de la taïga, verte et brune.
C’est une image évanescente, une lumière, un parfum, qu’elle portera dans son cœur et son esprit très longtemps. C’est le seul souvenir qu’elle gardera de ce voyage, qui les mena vers l’exil.
Nassia a neuf ans. Depuis quatre ans au moins, elle lit tout ce qui lui tombe sous les yeux et sous la main, les enseignes, le journal, les livres, ceux de son père même qu’elle feuillette parfois par curiosité, Nassia lit et parle le russe comme l’allemand avec une aisance que ses congénères lui envient parfois.
Il n’y a jamais, ou très rarement, d’instant tel que ta vie s’en trouve chamboulée. Et sa vie ce jour-là ne l’est pas. C’est juste une étincelle, qui met le feu à une poudre magique, qui elle modifie, commence à modifier, le regard qu’elle porte sur le monde.
En plein ciel, juste en-dessous des nuages : voilà bien un titre de journaliste. Une photo, celle d’une funambule, illustre cet article. Une légende : Camilla Mayer. En 1935, à Atlantic City aux États-Unis, elle bat le record du monde en marchant sur un mât à cinquante-trois mètres de hauteur.
Elle y pense en s’endormant.
Elle s’imagine comme un chat. Ce n’est pas assez. Elle s’imagine alors comme un oiseau. Son corps se fait aussi léger que celui d’un aigle, d’un corbeau, d’un moineau.
Elle y pense en se réveillant. Dès lors, Nassia observe parfois les toits des immeubles, regarde en l’air, non pas les nuages, mais en-dessous des nuages, au niveau de la ligne de corniche. Elle trace des lignes, tire, suspend un fil invisible, et toujours invisible, sans balancier, s’imagine, se voit, se projette marchant, dansant sur ce fil.
Nassia a dix ans. On est en 1936. Elle vit à Berlin. L’image de cette funambule sur son fil s’est estompée. Elle aime danser. Les cours de danse sont réservés aux Allemands. Elle ne porte pourtant pas l’étoile jaune. Impossible de déceler le vrai du faux dans les papiers qu’on a donnés à son père. Impossible aussi, impensable plutôt, elle n’y a jamais pensé d’ailleurs, de s’inscrire aux Jungmädelbund – les Jeunesses hitlériennes pour les filles. C’est Helena Ivanovna, une amie de sa mère, qui lui donne des cours de danse. Elle lui parle de Diaghilev, Nijinski et Tchaïkovski d’un ton où se mêlent intentions pédagogiques et nostalgie. Nassia elle n’a pas le mal du pays. Ses parents ont quitté Moscou en 1929 (elle n’a alors que deux ans). Une heure avant l’arrivée de la police politique, un ami les prévient. Ils s’enfuient, passent par la Finlande, redescendent, traversent le Danemark, y séjournent un moment avant de s’installer finalement, à l’automne 29, à Berlin. De cette fuite, Nassia n’en garde qu’une image : celle de la traversée de la forêt boréale de Carélie. C’est un paysage qui tapissera longtemps, semble-t-il, la toile de fond de sa mémoire. Son premier souvenir, écrit-elle dans son journal. Un paysage synonyme pour elle de grand bol d’air, d’espace soudain, de liberté. Peut-être a-t-elle simplement transféré sur cette image le soulagement de ses parents. Ils respirent enfin, de nouveau.
Berlin, devenue une ville interlope pleine de cabarets obscurs et de trafics louches, ravagée par une crise autant socio-économique que morale, n’est déjà plus à cette période ce qu’elle avait été à l’orée des années vingt : la capitale des exilés russes. Ils étaient alors plus de trois cent cinquante mille à y habiter (autant que les membres du parti nazi en 1930). Le quartier de Charlottenburg, à l’ouest de la ville, était communément appelé Charlottengrad. C’est là qu’avaient vécu Tolstoï, Maïakovski et Ilia Ehrenbourg. C’est là que Dmitri Vassilievitch et Irina Alexandrovna décident de s’installer.