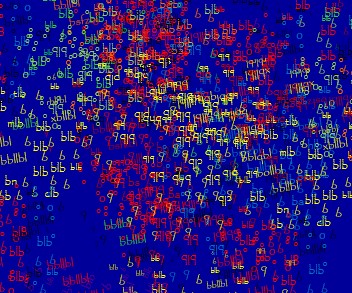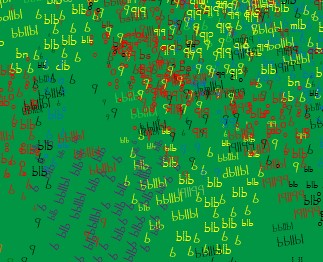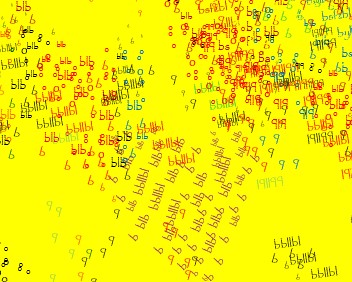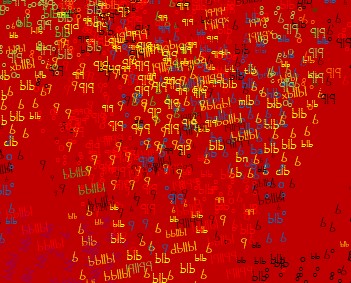Cher Bertrand,
C’est de l’autre bout de nous-même que je t’écris par cette nuit solitaire. Dehors, il n’y a plus aucun bruit. La ville est méconnaissable. On croirait qu’il vient de neiger. J’ai entraperçu tout à l’heure une forme passer dans la rue, j’ai d’abord pensé que c’était le renard qui a établi son territoire sur la friche des Guilands. Ce n’était qu’un chien, pas même errant.
Je me suis longtemps demandé comment et de quelle manière inaugurer cet échange qui croupit sur le seuil de nos insomnies depuis trop longtemps. Et puis j’ai pensé à ce bon vieux Ramon, le grand Ramon Gomez de la Serna, et à ses Lettres à moi-même : c’est l’éloignement qui me contraint à entamer cette correspondance. J’aimerais, vois-tu, clarifier deux ou trois points avec toi.
La fiction nous arrache à nous-même et nous permet de dessiner un horizon plus vaste. Je sais bien cependant ce que tes écrits me doivent. Je connais tes obsessions, elles me servent d’oreiller et de pensum la nuit, de ritournelles et d’arrière-pays le jour, quand je cuisine ou étend une lessive par exemple, de boussole quand je vais marcher, attentif aux plantes sauvages de nos rues, aux insectes et aux oiseaux qui mêlent leur monde et leur territoire aux nôtres.
Tu as la porosité d’une éponge. Comment peux-tu alors même penser que le corridor qui nous relie aurait l’étanchéité d’une digue ? : les embruns que chaque jour je disperse, tels des postillons, te brumisent, t’arrosent, te baignent même à certains moments. Nous respirons en osmose.
Tu sais pourtant, tu l’as toi-même mis noir sur blanc, que la vie se réinvente au quotidien, que l’écriture est semblable à une friche : y pousse ce qu’amène le monde, la vie, cette vie qui ne se joue pas ailleurs, mais ici, maintenant, demain, dans les liens que l’on tisse avec les autres, les projets que l’on rumine, puis que l’on porte et qui nous élève. Un zeste d’utopie ou de folie aide certainement parfois à ce qu’elle soit alors une puissance qui vous soulève de terre. N’oublie pas cependant que la vie, c’est avant tout des verbes et des sens que l’on conjugue au quotidien. Aimer, cuisiner, dormir, marcher, toucher, penser, lire, écrire, goûter, voyager, écouter.
Les écrivains en parlent peu de ce quotidien, qui semble la toile de fond invisible sur laquelle se découpe la vie. Pourtant il faut s’y coltiner, sinon quelqu’un d’autre le fera à ta place. On voudrait s’affranchir de toutes ces tâches qui pérennisent la vie, or elles nous enracinent au monde, nous rendent plus humbles (ou moins cons si tu veux), plus clairvoyants aussi. Le quotidien est aussi ce qui nous élève, ce qui nous change, imperceptiblement, au fil de l’eau qui nous coule dessus. L’ensemble est un équilibre, sous-tendu par cette inlassable question : comment vivre ? Bien, et toujours mieux, mais ensuite ? : tu participes à l’évidence de cette éthique qui chaque jour me meut. N’oublie pas alors que je suis tes racines, peut-être invisibles mais bien nourrissantes et peu avares de leur sève, celles aussi de l’horizon que tu déploies, élargis et enrichis sans trêve, celles tout simplement qui t’aident à respirer et aller plus loin. En un mot : je suis ton carburant.
Tu aimerais que tes paysages aient, comme la vision fugitive qui te hante depuis toujours, la lumière d’un champ de colza, celle d’une nuit étoilée comme il y a dix mille ans. Ce n’est parfois, ne l’oublie pas non plus, que la lumière des lampadaires du boulevard qui passe en bas de chez nous. Tes mots y gagneront sans doute en épaisseur et de simples pinceaux deviendront de petits hameçons qui, accrochant la peau du monde, en arrachent de petits bouts.
Je sais toutefois, enfin, que cette vie dont je te rebats les oreilles est une bourrasque permanente et qu’il te faut, même entouré de bruits et de gens dans ce café où tu écris, cette presqu’île, pour pouvoir tracer, lentement, dans l’ombre et en secret, tes lignes de fuite, celles qui innervent nos terres lointaines, celles qui font fuir tous ces divertissements, celles qui crèvent l’aquoibonisme qui nous saisit parfois et nous paralyse. Celles qui me permettent de respirer plus sereinement, plus amplement. Rien n’est séparé, vois-tu. Certes, le miroir que je te tends n’est qu’un miroir aux alouettes, il ne reflète qu’une image brouillée, déformée, mais même dans tes fictions les plus folles se dessinent en filigrane les lignes de mon visage. Nous sommes indéfectiblement liés. Sans toi, j’aurai la sensation de n’être qu’un cafard cavalant dans une nuit oppressante où manquent l’air frais, la perspective et même les points cardinaux. Aussi n’ai-je songé un seul instant à t’arracher à cette presqu’île. N’en fais pas un exil. Voilà tout.
– Toujours à jouer le garde-chiourme, à me remettre à ma place, hein ? Ai-je un seul instant penser à vivre en exil ?
– Ah te voilà. Enfin. Je désespérais.
– Tu ne me foutras jamais donc la paix. Et tu n’as pas répondu à ma question.
– Tu ne donnais plus signe de vie.
– Tu es trop bavard. Les lignes de fuite se tissent lentement. A trop se hâter, tu le sais, elles se métamorphosent en lignes de mort.
– Tu connais toujours, je le vois bien, ton Deleuze-et-Guattari sur le bout de tes doigts.
– Il n’est qu’un maître parmi d’autres.
– Nous sommes de grands lecteurs, je ne l’oublie pas.
– Bon, et ces verbes ?
– M’aiderais-tu ?
– Mieux. Je m’en charge. Tu verras que je n’ignore en rien la vie quotidienne qui nous sous-tend.
– Vas-y. Prends la main.
– Lire du coup.
– La transition est bien trouvée.

Lire nous réunit et occupe une partie de notre temps. Par plaisir autant que par nécessité. L’écriture d’un roman nécessite, en ce qui nous concerne, beaucoup de documentation. #pas de tribu. Des affinités électives : Henri Michaux, Nicolas Bouvier, William Faulkner, Kenneth White, Barbara Kingsolver, Richard Brautigan, Vinciane Despret, le haïku, les éditions Gallmeister, la collection Terre Humaine et la collection Biophilia des éditions José Corti.
– Tu as bien synthétisé. Et Henry Miller ? Donald Westlake ? William Carlos Williams ?
– Toi et tes Américains… Vas-tu citer l’intégralité de ta bibliothèque ? Passons à cuisiner, je sais que ça te tient à cœur.
Je dirai que tu n’es pas un légume. Tu n’as pas de pois chiches ni de petit pois dans la tête, tu ne portes pas de lentilles, ne pédales pas dans la semoule, tu espères ne pas avoir le melon et tu ne fumes pas d’herbe (sauf celles qui poussent au fond de notre tête) : tu les cuisines, le plus souvent accompagnés d’épices, douces et aromatiques (sauf les petits pois, tu y es allergique). « La cuisine est quelque chose de simple, de quotidien, la cuisine c’est la vie » : tu tiens cette citation de Michel Bras qui, arrivé à l’os (à moelle) de sa pratique, le revendique (tu vois, j’ai potassé un peu avant de venir). Comme on peut aimer tout à la fois la street food et la gastronomie, tu aimes cuisiner au quotidien comme pour les repas de fête.

– Ça te va ?
– Tu oublies de signaler que, sans être végétarien, je cuisine les légumineuses.
– Et les lentilles, c’est quoi ? Du mou pour le chat ?
– Pardonne-moi. Maintenant ?
– Le végétal, cela va de soi. Herboriser.

Terrain vague – ils se cachent
derrière la palissade,
les coquelicots.
– Dis donc, tu ne t’es pas foulé sur ce coup-là…
– Quoi de mieux que le haïku pour peindre une atmosphère ?
– Mouais… Bon et maintenant ?
– Habiter ?
Habiter : une maison, un lieu, une ville, le monde – la vie est faite de cercles concentriques -, une décharge, une niche, un nid, un territoire, un désert, s’habiter soi-même, être habité par des visions, et comme tu es un putain d’idéaliste, tu regardes aussi bien au loin que tout près, à tes pieds, pour connaître les coins, les recoins, les rues, les singularités et les espèces qui peuplent ce que tu appelles ton territoire, alors que tu n’es pas un animal. Tu habites Montreuil, c’est super Montreuil, hein ? Il y a de la mixité, des cafés, de grands parcs, des militants, des artistes et des travailleurs, des concerts et des librairies. Bref, ce n’est pas une ville banale, en tout cas pas une ville-dortoir.

– Non, c’est vrai. J’y mourrai sans doute d’ailleurs, loin de tes sarcasmes.
– Toujours les grands mots. Tiens, à ce propos, ta nécro, enfin je veux dire ta bio, on la met où ?
– J’écris, je te le rappelle, pour échapper à mon état civil. Renvoie-les à Linkedin, c’est fait pour ça.
– OK. Bon, allez, un p’tit dernier pour la route, et puis je filoche.
– Je bous d’impatience.
– Ton cheval de bataille. Écouter.

Les oiseaux (LPO oblige). La roue de loterie qui ressemble à la série de clics du cachalot, un palet glissant sur une patinoire, une chenille avançant sur une feuille de mûrier. Simple échantillon. Ta collection de sons est impressionnante, je l’avoue. Ah, comment ai-je pu oublier : ritournelle. Tu chantonnes à tout-va (c’est pénible parfois). Et puis de la musique – toutes les musiques, avec une préférence pour la Grande Musique Noire (du blues au hip-hop) et la chanson française (de Brassens à Mr Giscard). On a encore de la place ? Alors : une canette roulant dans le caniveau puis avalée par une bouche d’égout, le son cristallin du gong du moine zen, le claquement d’une mâchoire de caïman sur une jambe
– Ouais, bon, ça va !
– Jamais content…
– Tu n’as pas mentionné les sons disparus, ni mon activité passée de chroniqueur musical – et littéraire.
– Je suis constamment tourné vers l’avenir, l’œuvre la meilleure est toujours celle à venir.
– Sophisme. Préciserais-tu pour quelle raison j’y tiens, à tous ces sons ?
– Ben…
– Pour combattre la tyrannie de l’œil, qui est comme nos egos, un peu boursouflé.
– Tu n’as qu’à te crever les yeux, tu seras peinard.
– Rigole. Un petit régime d’amaigrissement et de désintoxication lui ferait du bien. Ça ferait un peu de place aux autres.
– T’as raison, on n’est jamais trop altruiste.
– C’est bon, décampe. Je t’ai assez entendu. Et donne des nouvelles de temps à autre, sans quoi, la prochaine fois, je lâche les chiens.