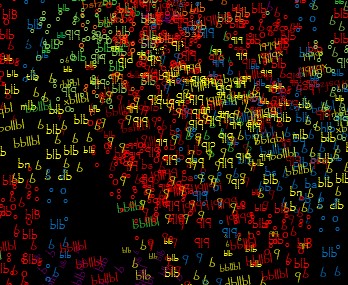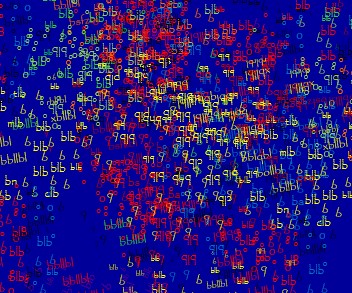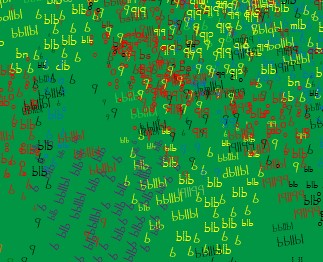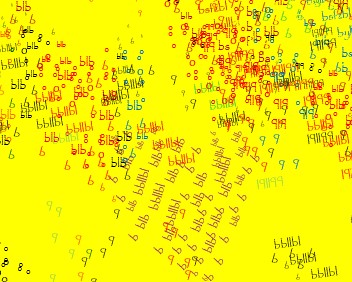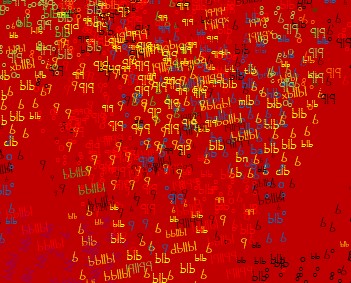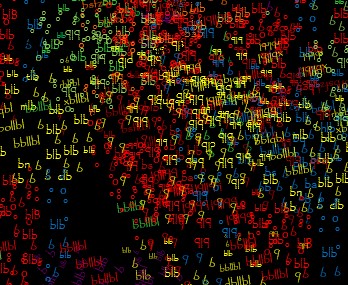Les deux nouvelles suivantes ont été écrites pour la revue inventive, singulière, belge et semestrielle Papier-Machine. Celle publiée dans le numéro 7 avait pour rédacteur en chef le mot Éponge. La seconde a été écrite sous la bienveillance du mot Corne.
Un des personnages principaux de Pas-Touche est une éponge, neofibularia nolitangere (ce second terme signifiant, littéralement, en latin, « ne touche pas » – au contact avec la peau, cette éponge, toxique provoque des brûlures qui durent plusieurs jours, des sensations d’engourdissement, jusqu’à des difficultés respiratoires en cas de récidive). Elle est partie d’une idée que j’avais en tête depuis longtemps et que j’ai développée et affinée depuis : prendre au sérieux la proposition d’Anna Tsing en fabriquant de nouvelles histoires où les espèces s’entremêlent, où les humains n’en sont pas nécessairement le centre – en trois mots de désanthropiser le récit. Écrire des textes en me mettant à la place de personnes non-humaines, en utilisant comme outil le concept d’umwelt (je vous renvoie à la page de Zoopolis). En bref, de m’atteler à l’écriture d’écofictions. C’est un texte expérimental, proche du poème, où le sens du texte, qui ne se donne pas d’emblée, se construit en lien avec la manière de percevoir de l’espèce concernée. La difficulté étant : quel langage pour une éponge, une langouste des Caraïbes, un banc de chinchards, un groupe de dauphins ? Quel umwelt ? Quelles préoccupations ?
Sur le site (ou plutôt le spot) où se déroule cette nouvelle, l’Anse Caffard, en Martinique, se tient un mémorial, Cap 110, érigé à l’initiative de la commune du Diamant lors du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, en 1998, en mémoire du naufrage d’un navire négrier, qui vint s’échouer sur les récifs de cette même anse dans la nuit du 8 au 9 avril 1830. Pour information, cette nouvelle fut pour moi l’embryon d’un roman qui verra le jour en 2024.
Pas-Touche
« Quand un homme a la mer pour cercueil
La création entière vient à ses funérailles. »
(Charles Olson, Poèmes de Maximus)
(neofibularia nolitangere)
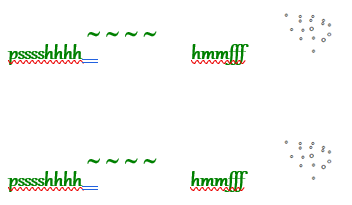
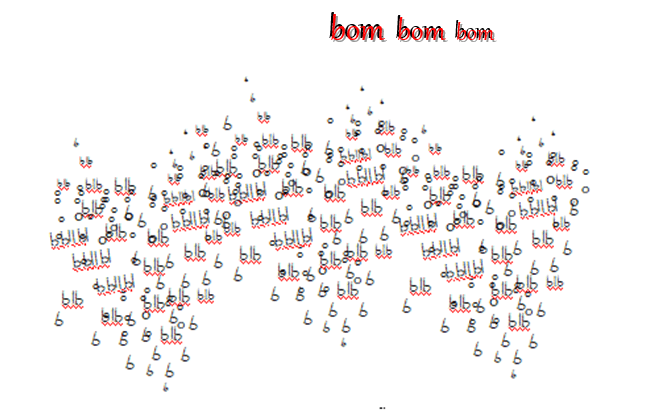
*
(panulirus argus)
une cache trouver une cache trouver une cache et s’y enfouir sous une roche dans le sable trouver une cache sous une roche et s’enfouir dans le sable ma carapace devant un leurre maintenant à l’étroit en changer maintenant la laisser devant à l’abri se mettre à l’abri
où ?
une cache trouver une cache à l’écart sous une roche creuser creuser hop hop sous le sable
puis s’enfouir siffler ça les égare
pas là toute-plate remue le sable
ici
voilà
à l’abri des courants et des couloirs
grandes-dents n’y viendra pas
six–bras n’y viendra pas
toute-plate n’y reste pas
cinq-doigts ne gênera pas
qui-pique ne gênera pas
rien vite vite personne
d’abord la tête les pattes rhhâââhhh les antennes ma carapace se
dé
tache
nu
vite
creuser
s’enfouir
siffler
qué ? QUÉ ?
bouge
ça BOUGE !!
ça bouge dans les fils-verts
une chose tombe une chose tombe sur le fond
particules de sable en suspension dans l’eau
Une autre.
Une autre.
Une autre.
c’est lourd
beaucoup de sable dans l’eau on ne voit plus rien.
tROU
*
(trachurus trachurus, en multitude)
qu’il y-a-t-il entendu comme un bruit sourd
plououssshhh ! eh ! quoi ! tombent ! corps trois groupés ! on reste groupés !
trombe bulles sable mousse sillage blanc et rouge corps quatre oh aïe aïe au fond sur les mousses-oranges au fond
ça vient d’en haut
ça vient d’en haut là où il n’y a pas d’eau
on se resserre soudés on reste soudés
en boule bouches-en-pointe entendu leurs cris au loin on boule on tourne
d’en haut ça venait d’en haut là où il n’y a pas d’eau
silence silence de quand six-bras remonte du noir
cache cache laminaire roches sable algues pfuit pfout fuz zig zag virevolt attendre
cachés lèvres-épaisses & ses laveurs dans les fils verts
jaunes-et-noirs longue-longue
chouuuff
bruits tapis
silence
plus personne
du gros
une ombre
gloups
six-bras
en boule surtout on reste en boule
grandes-dents
voilà grandes-dents grandes-dents à jeun jouent avec les corps
en boule toujours en boule voilà bouches-en-pointe ! deux ! trois ! quatre !
quatre bouches-en-pointe !
*
(delphinus delphis)
entends-tu une bande d’argentés, à deux minutes oui j’entends on les saute ? on les saute ! j’entends d’autres bruits au loin aussi ce n’est pas la tempête c’est autre chose c’est quoi d’après toi ? dehors ça vient de dehors je crois grandes-dents sont deux longue-longue bandargentés se sont mis en boule on fait quoi on fonce dans le tas comme d’habitude ok tu prends à gauche je les dégomme par en-dessous on les remonte
j’en ai eu plein moi aussi c’est quoi alors ce sont les lézom dehors lézom un bateau plein ils s’agitent un peu en haut et du ventre ça vient surtout du ventre du bateau gloups hap dans le mille bien joué vas-y par la gauche je les enfonce par la droite
des cris oui j’entends attention ils se reforment on plonge on fonce pour les disperser !
les cris viennent du ventre veulent sauter sur le pont lézom deux les empêchent de monter
t’en as eu combien sais pas me suis goinfré les cris plus fort oui je sens de la peur lézom en dedans de la peur & un autre bruit cliquetis c’est quoi d’après toi ça y est je sais ils ont des choses aux pieds qui les empêchent de monter peur de tomber lézom trois dans le ventre ont déjà essayé maintenant sur le sable au fond avec grandes-dents je vois regarde le bateau penche
à l’envers ! le bateau presque à l’envers ! lézom dans le ventre ils ne peuvent pas sortir aidons-les comment comment
regarde lézom tomber deux trois quatre de plus encore
par-dessus bord
corps noir blanc noir sur le fond sur le fond blanc noir noir noir
grandes-dents voilà grandes-dents un de plus un autre
rhhââ hurl arrghh des cracs le bateau sur les rochers comment les aider sont attachés sont attachés ceux au fond ne respirent plus rien on ne peut rien
viens on ne peut rien
*
(homo sapiens)
allez les genoux plie bien les genoux é-qui-li-bre faut que je garde l’é qui li brreeeee plouf trop marre je sors de l’eau tiens une vieille dame sur le bord elle ne m’a pas vu je vais aller voir ces sculptures moi aussi massives que des bustes je me demande ce qu’elles regardent allez mon paddle ici contre ce rocher la rame là et hop je monte hooouuu ça y est punaise impression d’avoir cent ans on voit bien la plage d’ici la Dizac aussi où qu’elle est la vieille elle est partie ? dix au moins quatorze quinze impressionnantes ces statues elles font bloc on dirait qu’elles sont disposées en triangle rienadire çapète je vais sans doute en savoir plus avec ces panneaux alors que disent-ils Mémorial de l’Anse Caffard puté l’hallu un naufrage ici 1830 8 avril 1830 nombreux morts noyés quand même des survivants 86 dont 60 femmes sauvés par les nègres de l’habitation Latournelle voit pas où c’est ah si tiens c’est devenu l’habitation Dizac après merde ! c’est mon hôtel ! trop fort ça Bonjour jeune homme ! (sursaut) Avez-vous besoin d’aide ? Euh… Non… Bonjour madame, enfin je ne sais pas… ce naufrage, les statues… vous… vous savez ce qu’elles regardent ?
(plus tard)
non mais j’ai du passer vraiment pour un débile « vous savez ce qu’elles regardent ? » avec ma voix chevrotante là et puis c’était marqué sur le panneau le golfe de Guinée oui bien sûr elle connaissait son sujet la vieille m’a tenu combien au moins dix minutes non ? il faut dire qu’elle est pas banale son histoire et puis cette transmission orale les anciens qui la racontaient ça l’est encore moins et moi… non mais quel con ! la petite et la grande histoire qui se mêlent pourquoi pas la minuscule et la majuscule non plus ? je me demande quel âge avait son arrière grand-père quand il a participé au sauvetage des naufragés par contre les corps recouverts de traces rouges intenses, les survivants qui avaient souffert d’intenses brûlures je sais pas si ça tient son truc tu visualises le coup toi tu plonges et tu remontes cramé ! si c’est vrai ils doivent en voir un paquet de plongeurs à l’hôpital de Fort-de-France ceci dit l’interne qui lui a donné l’info devait savoir de quoi il parlait bon portable l’ai mis où ah oui ici doit rien capter ici ah si alors gougueule comment elle a dit pour les brûlures ah oui pas-touche alors é-pon-ge pas-touche résultats ah voilà neofibularia nolitangere ouais corps-du-Christtttttt ne-me-touche-pas tâches massives brunes orangées bosselées parfois OK …ok… ah voilà au contact avec la peau, cette éponge provoque des brûlures qui durent plusieurs jours on y est et même des sensations d’engourdissement ! et en cas de récidive des difficultés respiratoires !! ouah chaud l’éponge… une vraie dure à cuire et ils disent quoi eux quasiment la même chose ah non à certains endroits peuvent même avoir de larges cheminées exhalantes
veux en avoir le cœur net Allez hop tuba lunettes palmes
paddle pagaie et ploc comme la grenouille rame dans 50 m là plonge
lumière bleue rubans verts trop beau devrait faire de la plongée moi sable mue pas un crabe une langouste ? raie ô rayés jaunes-et-noirs ORANGE taches oranges merde l’avait raison taches oranges partout mousse plus d’air bientôt oucchh rocher pas vu rrroucch me suis brûlé c’est pas des conneries j’en suis sûr maintenant c’est ce qui s’appelle plonger dans l’histoire remonte faut que j’remonte
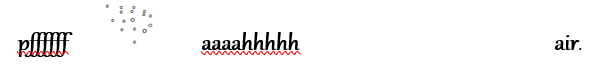

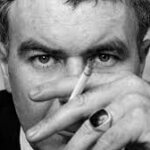






Cette nouvelle n’aurait sans doute pas vu le jour sans la proposition de Papier Machine, qui pour son numéro 8 a confié les clés du camion au mot « Corne ».
Du désert sous la lune est un texte d’anticipation. En 2418, en quête de la définition d’un mot énigmatique, « corne-de-gazelle », un groupe de chercheurs monte une expédition quasi archéologique dans le but de trouver un dictionnaire – je veux dire un véritable dictionnaire, matériel, constitué de vraies feuilles – dont il existe peut-être, quelque part, encore un exemplaire.
Du désert sous la lune
Post du 15/12/2418, 15h02
Hola Ruan,
C’est Ari. Désolé, j’ai la voix enrouée. Trop de pop-up-foil, hier soir.
Je suis bien content d’avoir eu de tes nouvelles. Nous avons bien survécu à l’ouragan du début de l’année. La routine. Ici le désert avance bien, merci. D’ici peu je pourrai me lancer dans ma production de cactus. Ce sera une réserve d’eau bien précieuse qui sera, ma foi (et dans le foie, tu le sais mieux que moi, histoire de gènes et d’ADN, c’est toujours la première souche qui compte), la bienvenue.
Je me souviens de Young, je l’ai croisé une fois sur le RZO, il menait de front deux conversations, l’une dans un dialecte thaï, l’autre en gaélique. J’ai déjà vu ce genre de partition mentale chez un 180.
Pour répondre à ta question – et à la sienne, je ne sais pas d’où vient ce terme « corne-de-gazelle ou gazel », je ne sais pas vraiment comment l’orthographier.
Pour répondre à ta question – et à la sienne -, je ne sais pas d’où vient ce terme « corne-de-gazelle ou gazel », je ne sais pas vraiment comment l’orthographier.
Je vais tenter de me renseigner plus amplement. Houlai.
Post du 15/12/2418, 17h38.
Saluton Ari,
Je n’ai eu ton message que tardivement. Mon transcripteur mental a des vapeurs, j’ai dû me déconnecter et activer la fonction vocale pour l’écouter. Tu avais l’air ruiné. Arrête le pop-up-foil, mec, ça dézingue les neurones.
Si tu trouves un opuntia, une espèce de cactus qui poussait autrefois en Australie, mets m’en un de côté. Ce nom m’intrigue. Bob m’assure que la \ga.zɛl\ était une herbe du littoral, qui aurait disparu à la suite de la Grande Marée. Je me méfie des déclarations de Bob, souvent noyé par ses lubies. Il semblait néanmoins sûr de lui et
– Salut Ruan, je t’interromps.
– Ah salut Ari.
– Mon p’tit coco, ses herbes, ton Bob peut les ruminer tout seul. Ça y est, j’ai trouvé. Eurêka, comme disait l’autre !
– Qui ça ?
– Ben l’archimède… l’archimède de Rome… Bon, j’ai une piste. Le \ga.zɛl\ serait une contraction de gaz naturel, je te parle de l’époque des chasseurs-cueilleurs où l’on pouvait, grâce aux extracteurs de poche, le ramasser dans la nature. J’ai dégotté ça sur une base du siècle dernier. Le terme serait tombé en désuétude vers 2150, puis réhabiliter et détourner pour désigner les gaz de fermentation de toutes sortes.
– Ouais. À mon avis, c’est un homonyme. Je verrai avec Young…
– Où a-t-il déniché ça ?
– Je ne sais pas, d’une archive sonore je crois. Ce qui est certain, c’est que son intérêt vire à l’obsession. Il ne nous lâche plus, et son enthousiasme semble partagé en haut lieu. À part ça, ton transcripteur ?
– Il assure être incompatible à l’esperanto, retranscrit une partie des textes en mandarin du XVIIe, me prête les pensées d’un chimpanzé, mais à part ça tout baigne, j’ai pu me reconnecter… Bon, et toi ?
– T’inquiète. J’ai pris rendez-vous chez le popologue pour une greffe de neurones. Il a fait un prélèvement hier. J’attends ses analyses. Allez, brutcho.
– OK. Brutcho.
Post du 15/12/2418, 19h07
Salut à tous les deux,
C’est Swal. Je suis un shlum de Sinto, des Langues-Am.
J’ai vu dans le RZO l’archive de votre dernier spot. Je suis de l’avis d’Ari. C’est sans doute un faux-ami, un traître même si vous voulez, comme dans cornichon qui mal y panse (le proverbe niçois) : rien à voir avec le vrai cornichon, qui est un légume que l’on mangeait autrefois en condiment. Je dois avouer cependant que l’échappée – et la part laissée à l’imagination – était belle et audacieuse. L’idée de la métaphore me semble intéressante.
Ce type de mot n’est pas très courant dans les langues américaines primitives. J’en ai malgré tout discuté avec Sam, ma responsable d’équipe. Nous ne sommes pas d’accord, mais ça pourra peut-être vous aider. Elle pense que ce pourrait être un animal mythique, un peu comme la licorne, ou le cornard (appelé parfois cocu). Il semble qu’un dénommé Molière – sans doute un naturaliste ou un fabuliste – l’évoque à plusieurs reprises dans ses ouvrages. Aucune occurrence dans le RZO. Trop vieux sans doute.
Je partirais quant à moi plutôt sur une métaphore, du type cornichon justement, ou encornet, corne de cerf ou cornegidouille, un juron autrefois utilisé par les Gentils, et qui signifiait littéralement « corne de bedaine ». C’est en tout cas une certitude : la corne-de-\ga.zɛl\ a pour moi la forme d’une corne. Nous serions bel et bien en présence d’une analogie. Ce pourrait être aussi par exemple un instrument de musique, comme la corne de brume. Arriverdé.
Post du 15/12/2418, 20h16
– Salut Swal, Tu me captes ?
– 5 sur 5 !
– Young a du nouveau. Il arrive
– Je l’entends.
– Saluton al ĉiuj,
– Saluton Young. Ça va ?
– Ça va, ça va… Cette foutue corne, je n’en peux plus… Elle reste insaisissable. Je ne sais pas par quel bout la prendre. Tant que nous ne saurons pas ce qu’est un ou une \ga.zɛl\– ou que nous n’aurons pas au moins une idée de son contexte d’usage -, on ne saura pas où placer le focus. Au Siège, ils me mettent la pression.
– T’inquiète, mec, on trouvera.
– Ouais. Sûr. Sinto a raison. J’en fais une affaire perso.
Je vous remercie. Je me suis connecté en cours de route, mais CQ3 mon assistant m’a fait un historique des spots disponibles sur le RZO. J’ai recoupé toutes les infos que j’ai pu récolter à droite à gauche. L’intuition de Swal était bonne, c’est sans doute un objet qui a la forme d’une corne. Je pense qu’on est sur un type de mot analogique, d’avant la Datazère. Du coup, j’ai reconfiguré mon algorithme en fonction : c’est de l’ancien français.
– De l’ancien français ?
– Oui je sais, ça paraît surprenant. Celui que l’on parlait dans quelques régions européennes bien avant que le français classique ne soit instauré.
– Ça remonte à quand du coup ?
– 2100 à peu près.
– Et alors ?
– Le français classique a cessé d’être une langue administrative en 2105. Elle a été parlée encore pendant des décennies, avant de disparaître peu à peu, d’abord comme langue usuelle, puis comme dialecte local. Elle est encore entendue ici et là, dans certains quartiers de Paris isolés – ceux sécurisés du Granwest notamment – jusqu’en 2200. C’est dans secteur qu’il faudrait chercher.
– Mais chercher quoi ?
– Un dictionnaire. Un dictionnaire local, oublié dans une vieille base de données.
– Ouais. Pas gagné…
– Tu as lancé un mouchard ?
– CQ3 vient de le faire. Il a lancé un mouchard et posté une demande sur le RZO. Je vous tiens au courant.
Post du 16/12/2418, 00h23
Je viens d’avoir une réponse du RZO.
Je voulais vous en parler. J’ai vu sur vos agendas que vous étiez tous libres demain juste avant midi. Je me connecterai à l’interface à cette heure-là.
Post du 16/12/2418, 11h48
– Saluton al ĉiuj
– Saluton Young
– Tout le monde est là ? Bon. Je n’ai pas de bonnes nouvelles. Les bases de données n’ont rien donné. Le terme avait déjà dû disparaître, ou peut-être était-il simplement de nature trop vernaculaire pour figurer dans les dictionnaires.
– On fait quoi alors ?
– On continue. La zone de recherche ne change pas, mais nous cherchons désormais un dictionnaire physique… je veux dire… en papier, fait avec du vrai bois…
– Hein ?
– Je comprends ton étonnement, Sinto. Il semblerait que ce ne soit pas un mythe… J’ai consulté une biblio-archéologue. Il en existerait peut-être encore un ou deux exemplaires, en ancienne France, dans une zone appelée autrefois la Transilienne. Le site est une ancienne bibliothèque, située au bord d’un fleuve. De ce que j’en sais, les façades en verre n’auraient pas survécu aux tempêtes de sable, mais, ma source est formelle sur ce point, les archives et une partie des livres avaient étaient enterrés. Selon elle, les probabilités que nous le trouvions sont élevées. Les conditions de stockage étaient optimum.
– Comment être certains que personne ne sera passé avant nous ?
– Pour une bonne et simple raison. Vous pouvez ranger vos casques de Recherche Virtuelle. Cette zone n’est pas balayée par le RZO. J’ai essayé de m’y rendre : je n’ai fait que longer la lisière sans pouvoir y pénétrer.
– On pourrait peut-être lancer un drone physique, le piloter à distance serait un jeu d’enfant… J’imagine que dans cette zone les ondes cérébrales ne devraient pas être trop brouillées.
– Tu as raison sans aucun doute, mais c’est impossible.
– Ah ?
– Là où nous devons chercher les robots n’a pas accès. Il doit s’agir d’une zone hautement contaminée, ou d’une zone Top secret, placée sous la juridiction des Armées Européennes. Je n’en sais pas plus pour l’instant. Ajouté au fait que le décryptage de ce mot composé « corne-de-\ga.zɛl\ » pourrait constituer une avancée considérable d’un point de vue scientifique, vous avez compris que dans le cas où nous mettions la main ce dictionnaire, nous serions en possession d’une relique inestimable… Je ne vous cache pas que le Siège en a fait sa priorité…Bref, ils sont prêts à monter une expédition… L’autorisation d’entrée sur le territoire est en cours.
– …. …
– Chacun est libre d’y participer, cela va de soi. Je ne peux évidemment pas vous pousser à en faire partie. Ça ne relève en aucun cas de vos attributions. Les Langues-Mo ont engagé des chercheurs, des linguistes, pas des mercenaires. Vous avez quelques jours devant vous, le temps que nous montions cette expédition, dont je serai bien entendu. Je me tiens à votre disposition. Bonan tagon al ĉiuj.
Archive postée sur le RZO le 15/06/2429, par Sara Ngemwa.
C’était en 2418. Je fus de ceux qui participèrent à l’expédition « Libernation ». C’est Young Kunta Kol lui-même qui me contacta. Il n’était pas encore célèbre à cette époque et pour cause, puisque cette expédition fut à l’origine de la découverte qui fit de lui un chercheur renommé.
Nous étions quatre. Young, moi-même, Sinto Luz, un linguiste des Langues-Mo, et enfin, Helena Sigueira, une biblio-archéologue, qui malgré sa peur et le danger inhérent à l’expédition, fut comme moi incapable de refuser cette opportunité – ni plus ni moins l’aboutissement, le rêve d’une vie de chercheuse.
Nous partîmes le 27 décembre 2418 en début de matinée. Un drone nous déposa en lisière de la Zone E34, un territoire de 3500 km2, contaminé – entre autres – à l’uranium « appauvri », hautement radioactif, et interdit au public depuis plus de cinquante ans. Cette zone était devenue depuis une prison à ciel ouvert, au sein de laquelle nous devions dénicher un livre, en voie de décomposition dans une salle souterraine.
Pour des raisons de sécurité, nous n’eûmes pas l’autorisation de survoler le territoire. On nous affecta un véhicule tout-terrain, et Alex Bool, un militaire engagé, nous avait-on dit, pour son sens affuté du terrain (tuer un homme à mains nues par exemple).
Franchir le poste de contrôle ne fut qu’une formalité. La muraille d’enceinte nous parut, de ce côté-ci, comme l’ultime survivance d’une civilisation perdue. Les routes défoncées, pleines de nids-de-poule, de sable, de touffes d’herbes, étaient jonchées d’objets divers. Nous pûmes apercevoir un sanglier et trois chevreuils s’enfuir à notre approche, admirer une bande d’aigrettes et un faucon s’envoler, quelques silhouettes humaines se découper au loin dans le paysage ; nous traversâmes des villages abandonnés, des zones industrielles désertes, recouvertes de publicités désuètes, ne roulant qu’à vitesse modérée pour pouvoir observer à droite, à gauche.
Ce n’était pas le paysage d’apocalypse que nous avions imaginé. La végétation luxuriante, exubérante, avait repris ses droits un peu partout, jusqu’au cœur des villes, minant le béton, crevant le bitume, les toits et les chaussées.
Ce n’était pas non plus la vie sauvage que nous attendions, celle d’hommes revenus à l’état naturel. La plupart de l’ancien tissu urbain était en déshérence, mais ici et là des foyers de vie, des communautés d’hommes, de microcités même parfois, avec ses corps de métier, sa vie sociale, ses infrastructures, même sommaires (électricité et eau courante par exemple) semblaient s’être organisés.
En début d’après-midi, nous avions parcouru plus de trente km. Bool stoppa notre bahut au sommet d’une colline. Nos dosimètres n’indiquaient plus que 4,5 microsieverts par heure – exposition assez légère pour pouvoir enlever nos casques et ouvrir nos combinaisons, pour nous restaurer avant d’arpenter le terrain. Malgré sa vieille carte routière, Bool ne découvrit qu’en fin de journée ce que nous cherchions : au creux de la vallée serpentait une sorte de chemin, à peine, une ligne sinueuse et ensablée, mais de laquelle sortait une végétation qui révélait la présence souterraine d’eau. Coulait ici autrefois une rivière.
Le soir même, nous dressions le camp à quelques kilomètres en aval, en bordure de l’ancien port de commerce. Peu de temps après minuit, je pris mon quart. Ce n’est pas tant la luminescence du ciel étoilé qui m’envoûta que la profondeur du silence – le silence de cette zone, paradoxe troublant, retournée à l’état naturel, qui avait tout l’air d’une réserve et qui était l’envers d’une réserve. Tout paraissait sain et intact, et pourtant tout était contaminé, atteint autrefois jusque dans ses fondements : n’avez-vous jamais observé un échantillon de molécules fraîchement irradiées au microscope ?
Au petit matin, nous n’eûmes qu’à suivre le fleuve pour entrer dans l’ancienne Cité, déserte dans ses quartiers sud, pour arriver au terme de notre voyage. Bool se posa sur ce qui devait autrefois être un embarcadère. Young déplia sa carte. Nous nous aventurâmes alors dans les rues, en quête d’indices (un nom de rue encore lisible, un numéro, une enseigne même à moitié effacée ou de guingois) pour nous guider jusqu’en lieu saint : la façade de la tour, faite de verre et de métal, était crevée de part en part de larges brèches. Bool défonça sans peine la porte d’entrée à la hache. La Bibliothèque n’avait rien d’un sanctuaire. La lumière que semblait amplifier les baies vitrées avait comme aspiré à la paille toutes les couleurs ; la moquette, plissée, presque spongieuse, semblait avaler nos pas. Le plus compliqué fut au final de dénicher entre toutes les portes celle de l’escalier qui menait au sous-sol. Dès les premières marches, l’odeur de poussière et de moisissure nous prit à la gorge ; les murs semblaient sourdre d’une rumeur microscopique. Je posai ma torche pour installer et allumer un de nos projecteurs : ce sont des kilomètres de rayonnages de livres qui se profilèrent alors, en clair-obscur, dans notre champ de vision. Des rangées interminables de livres physiques, comme nous n’en avions jamais vues. C’est Young le premier qui osa, d’abord du bout des doigts, effleurer un des ouvrages, le caresser de l’index, avant de le faire glisser sur l’étagère pour s’en saisir : il ne put toutefois achever son geste – la reliure se délita, les pages s’effritèrent. Grignotées par la rumeur microscopique, celles des cafards, friands de papier qui fuyant la lumière se carapatent, des rongeurs qui détalent le long des plinthes, celle inaudible des termites, des poux de livres, des poissons d’argent férus de colle, de tous les champignons microscopiques enfin (plus de deux cent d’après Helena), qui s’attaquent aux documents des bibliothèques. Je ne saurais vous décrire quelle fut l’expression de Young son ouvrage en miettes à la main, balayant du regard les rangées de livres, de milliers de livres qui comme dans un mauvais rêve s’apprêtaient à tomber en miettes. Nous n’en menions pas larges. Les visages tirés, parcheminés même, par la déception, nous achevâmes malgré tout, consciencieusement, notre visite. Seul Bool (qui n’était en rien parcheminé par ce qui arrivait – Bool était un soldat, il menait ses missions sans état d’âme jusqu’à son terme) ne se laissa pas démonter. Il ouvrit chaque porte, défonça chaque armoire, méthodiquement. À chaque fois, il n’attrapait que des ouvrages qui tels des hérons cendrés dont on vient de briser les pattes, s’écroulaient, cessaient soudain de faire corps.
Au terme de deux heures acharnées de recherche, alors que nous patientions en bas de l’escalier, lui enjoignant de lâcher l’affaire, il s’arrêta enfin. Pouvions-nous venir un instant ? : une fissure verticale, trop régulière pour être accidentelle, traversait le mur. Et, regardez, il y en a une autre, ici. Ce n’est pas tout. Observez bien la paroi. Ne voyons-nous pas ces rayures, presque imperceptibles, comme fondues au mur ? Et ces petits points, ne dirait-on pas comme de petites serrures incrustées à la paroi ?
Il ne lui fallut que quelques minutes pour venir à bout de la première. Le tiroir qu’il venait d’ouvrir coulissa presque de lui-même. C’était un tiroir taillé sur mesure, qui épousait tout à fait la taille et la forme du livre qu’il abritait. Il le saisit délicatement avant de le tendre à Helena, qui ne put, elle, s’en saisir tant ses mains tremblaient. Je le fis à sa place. Je l’ouvrai, le dépliai. Le papier, certes jauni, plus fragile qu’à l’habitude, ne s’effritait pas. Le visage d’Helena, qui patientait à mes côtés, s’illumina. Elle chaussa ses gants, empoigna le livre à son tour, avec une délicatesse de joaillier, le posa sur une table, l’ouvrit, puis ôta ses gants, et fit ce que sans doute aucun de nous n’aurait fait : elle passa l’index de sa main droite sur le bout de sa langue, le posa au coin de la première page, la tourna, puis après l’avoir parcouru, le regard droit et hypnotique, recommença ce rituel, page après page.
Les murs de la Bibliothèque, comme ceux d’un crématorium, étaient constellés de petites cases, qui chacune conservait, à l’abri des éléments et de toute espèce prédatrice, un livre bien vivant.
Il nous fallut toute la journée du lendemain pour les extraire un par un de leur cachette, et remplir deux malles chacune pleine d’une centaine de livres, parmi lesquelles il n’y avait aucun dictionnaire.
La découverte de ce « gisement » fit grand bruit – publicité qui nous permit au final d’avoir le fin mot de cette histoire : celui qui nous avait mené jusque dans la zone E34, ce corne-de-\ga.zɛl\ mystérieux, qui continuait à se dérober à nos investigations.
La réponse vint contre toute attente d’un éboueur, qui tomba dans la décharge dans la Décharge du RZO sur de vieux fichiers numériques – une monographie très renseignée sur l’histoire de la traduction et de la réception des ghazels, des enregistrements sonores et une vidéo susceptible de nous intéresser. En plein désert, entouré d’arbres squelettiques ornés de milliers de pierres, un vieil homme, malingre et barbu, saute, danse, fait la roue, le trépied, et, levant les bras, tourne sur lui-même comme pour s’envoler.
Vous pouvez toujours trouver cette vidéo sur le RZO (il vous suffira de taper Jardin de Pierres[1]).
Ce film semble l’illustration et la mise en gestes parfaites du ghazel. Le ghazel un poème. Et même un poème d’amour assez courant autrefois en Perse (une région du monde située autrefois entre le lac Persique et le désert salé iranien), un poème que l’on chantait les nuits de pleine lune en tournant d’abord sur soi-même afin de trouver l’ivresse, d’atteindre l’extase mystique et amoureuse propre à sa déclamation. La corne-de-ghazel serait du coup, ça coule de source, un accessoire amoureux, dont je vous laisse imaginer et inventer les usages qui vous iraient le mieux. Je ne vous fais pas de dessin – ce ver (d’un dénommé Hâfiz) le fera tout aussi bien, et bien mieux que moi :
Puisse mon âme être immolée à Ta Bouche,
car au jardin du regard
le Jardinier du monde n’a rien noué
de plus beau que ce Bouton de rose.
[1]https://www.youtube.com/watch?v=FAISFy9sZL4.