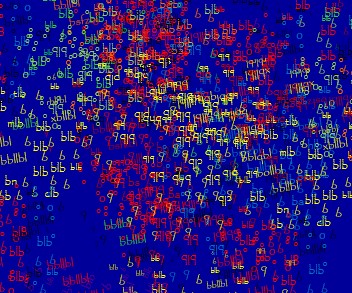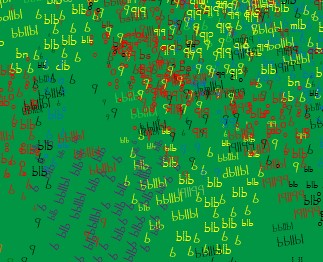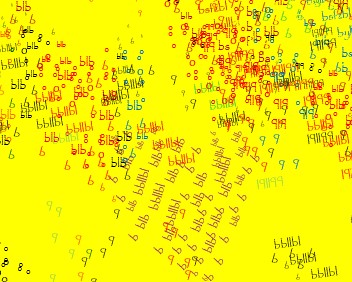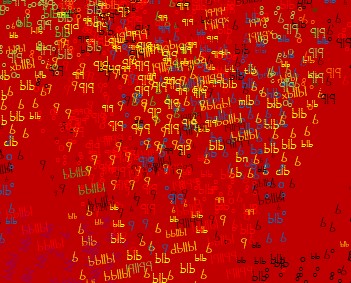J’ai regardé par les fenêtres tachetées de mouches et contemplé la vue à couper le souffle sur la chaîne des Absarokas. (Ianthe Brautigan, La mort n’est pas contagieuse, Éditions Page à Page).
Le sable est cristal
comme l’âme.
Le vent l’emporte
au loin.
(« Chandeliers flottants », in Journal japonais)
Connaissez-vous Richard Brautigan ?
C’est un des écrivains auxquels je reviens à une fréquence qui n’a de mesure que mon désir d’ouverture. Quand je sens que les portes se ferment, que je me clos, m’enroule sur moi-même, ou que je cherche un coin de ciel bleu pour m’abriter, il y a parfois un chemin qui mène jusqu’à lui.
Ses textes, tissés de vent, de rien, déjouent sans cesse l’immobilité, l’esquivent, la surpassent et laissent s’évaporer une profonde et douce mélancolie. Mais tout y est toujours sans importance, fluide et léger – poésie de l’instant. « Dans son quotidien comme dans son écriture, mon père avait la capacité à faire durer l’instant. Ce talent presque zen à habiter des fractions de temps étaient une des choses qui faisaient de lui un homme vraiment formidable », et un écrivain des plus singuliers. Ce talent touche à la perfection dans Tokyo-Montana Express, un recueil – quel mot laid et moribond, il rime avec cercueil – disons, une multitude, un essaim ou un herbier (c’est le mot qu’utilise Marc Chénetier, un de ses traducteurs) d’instantanés, de petites épiphanies, écrites sous forme de proses minuscules qui ressemblent à des haïkus, ou qui en ont le parfum. Les instants, Brautigan les saisit avant qu’ils ne deviennent de petits cailloux. Quand ils sont vivants, encore flocons de neige, petits ruisseaux, feuilles qui volent au vent ou nuages. Il écrit de lui-même dans TME : « Comme si dans l’Histoire chacun n’avait pas un rôle à jouer. Comme si moi, mon rôle, ce n’était pas de m’occuper des nuages ».
Instant, parfum, fluidité, ouverture – ses textes, où circulent l’essence même du haïku, semblent dire : « tout ça, ce n’est rien ».
Il y a ce parfum d’impermanence, et son économie d’écriture. Brautigan est un écrivain mineur – comme Deleuze le disait de Beckett et de Kafka. Il mine la langue, retranche, pour arriver à l’os même de la langue vivante, dès lors non pas sèche comme un squelette, mais volatile comme une boule de plumes ou un passereau – des phrases simples bâties autour de verbes d’action. Vous ne trouverez chez lui que très peu de mots morts, de relatives, de conjonction et de subordination, pas mal en revanche d’indépendantes juxtaposées. Chaque phrase, simple et autonome, semble une invention verbale, faite de mots simples, de quotidien et de poésie, jusqu’à saturation.
Tout ça, ce n’est rien – j’y reviens. Ce rien fait de ses textes de petites machines de guerre, contre les grands romans, aux structures lourdes, saturés de sens et bourrés de personnages – romans étatiques pourrait-on dire ; contre les écritures labyrinthiques, contre la logique, contre l’intrigue et la narration qu’on déroule comme un tapis rouge, parce qu’elle part et parle d’un passé. Faites de petites sensations et de présent, tissées de motifs sur lequel il dérive, un peu sans queue ni tête, les histoires de Brautigan sont « ce qu’il écrit au fil de la plume, c’est tout ; un mot pousse l’autre ». Vous n’y trouverez pas non plus de lignes droites, de portes, de statues (enfant, les statues le terrifiaient. Il faisait des détours de plusieurs rues pour les éviter. Il croyait que des gens étaient enfermés vivants dedans) ou de lieux clos – même dans Sucre de pastèque, l’Usine à Oubli semble ouvrir sur autre chose qu’un lieu clos. On est à ciel ouvert. À contempler les nuages. De l’eau partout, beaucoup d’air et d’espace. Voilà ce qui m’étonna et me saisit à sa première lecture : ce sont des textes à ciel ouvert, à l’espace clair et serein – fidèles en cela à une certaine Amérique, celle de Thoreau, des hobos, de Gary Snyder et des poètes beats. Mon horizon s’en trouva élargi.


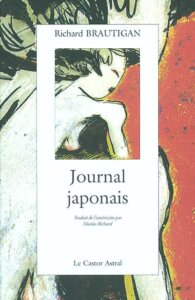

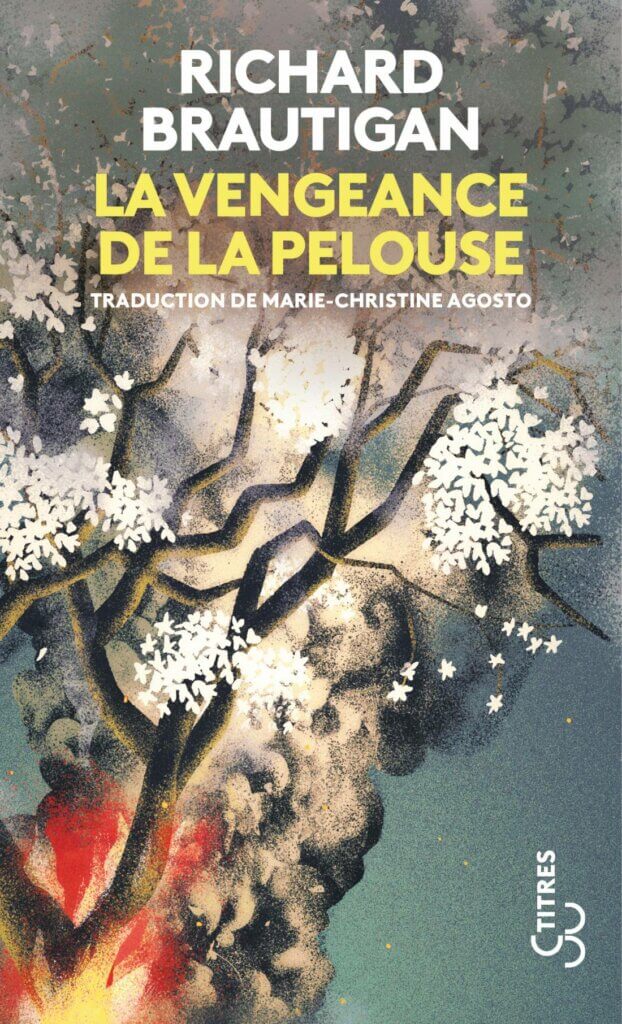

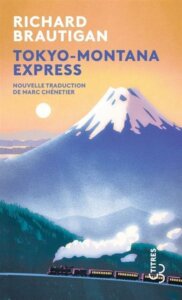
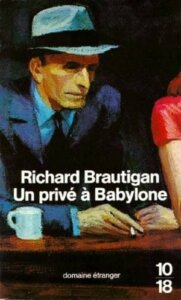
À part Tokyo-Montana-Express, qui a ma faveur (pas celle de Raymond Carver, qui, à sa sortie, l’assassina), il y a, bien sûr, La Pêche à la truite en Amérique. Et Mémoires sauvés du vent.
J’aime vraiment beaucoup Mémoires sauvés du vent. C’est un texte en partie d’inspiration autobiographique. Les souvenirs n’y tombent cependant que comme des confetti (rien d’une pluie). Il nous donne de son passé qu’une poignée de molécules, qu’il a pu sauver du vent, de son enfance que le parfum. Rien n’est identifiable. Mais il s’agit bien de lui, de sa mère, de quelques souvenirs, de la pauvreté (extrême d’après sa fille : il était, écrit-elle, « considéré comme un de ces enfants crasseux du sous-prolétariat blanc », engendré par la Grande Dépression) dans laquelle il grandit. La lumière y est jaune, légèrement dorée, comme celle que l’on trouve dans les tableaux de Russell Chatham, l’air trouble et léger, toujours.
Bon. Et puis : La Pêche à la truite en Amérique. Un drôle de type, la-pêche-à-la-truite-en-Amérique. C’est un peu tout le monde, la-pêche-à-la-truite-en-Amérique : un clochard, un cheminot, toi, moi, un copain de beuverie, Richard Brautigan lui-même, et même les ombres de Nicks Adams et Huckleberry Finn. Et il est tellement bien tout le monde qu’on ne sait pas du coup où il est passé – avalé par le paysage.
Il reste l’Amérique. Et elle a une sale gueule, l’Amérique. Elle a bien un peu l’air de celle de Thoreau, Twain ou Whitman, mais fatiguée, au bout du rouleau. Et au bout du rouleau (celui de Kerouac par exemple), il y a l’océan et un cimetière de voitures, à Cleveland. C’est là que finit la grand-route. Il n’y a plus d’herbe verte, mais des terrains vagues, des rivières polluées & des cimetières à l’abandon. Et toujours de la poésie. Beaucoup de poésie.
Que dire plus ?
Peut-être qu’il est ici et là question d’innocence. Perdue ou sauvegardée.
Peut-être aussi, et bien, par exemple, outre le fait qu’il joue avec les codes des genres (qu’il va revisiter de manière quasi systématique – du polar au roman gothique) et les parodie, qu’il y a aussi beaucoup d’humour – Brautigan ne joue jamais à l’écrivain sérieux et profond.
Il y a aussi une sorte de modestie (et de tendresse) à l’égard de tout et de tous, et une dimension que je trouve aussi chez d’autres poètes américains, William Carlos Williams par exemple : les petites choses. À ce propos, il écrit dans Tokyo-Montana-Express (le 92e arrêt) : « Je passe une grande partie de ma vie à m’occuper de petites choses, de petits bouts de réalité semblables à la pincée d’aromates que l’on ajoute dans un plat si compliqué qu’il faut des jours pour le préparer, parfois même beaucoup plus. »
Le bonheur qu’on trouvait dans ses textes ne lui suffisait pas. Ce bonheur émanait paradoxalement d’un être mélancolique, miné par la tristesse et l’alcool. « Il m’a dit, rapporte sa fille, que, parfois, les réflexions qu’il se faisait étaient si compliquées que cela formait des toiles d’araignée dans son esprit et qu’il ne connaissait pas d’autre solution que de boire pour s’en débarrasser. ». Il pleut également beaucoup dans les livres de Brautigan.
J’aime bien ce chauffeur de taxi
Qui fonce dans les rues sombres
de Tokyo
comme si la vie n’avait aucun sens.
Je me sens pareil.
Richard Brautigan s’est un jour tiré une balle dans la tête à l’aide d’une carabine .44 Magnum. Son corps fut retrouvé dans sa maison de Bolinas, Californie, le 25 octobre 1984. Il était sans doute mort depuis quelques jours.
On a installé sa tombe au fond d’une rivière, dans un cercueil de verre, puis on y a fait pousser des lichens phosphorescents : sa tombe brille dans la nuit à la manière d’une luciole. Il me plait de croire que Jim Harrison, qui fut très affecté par la mort de Brautigan, a peut-être pensé à son ami en écrivant La Femme aux lucioles.