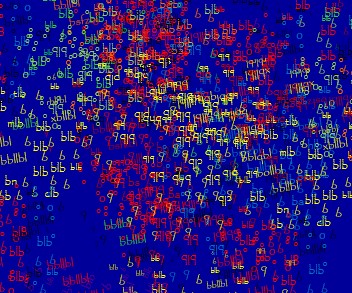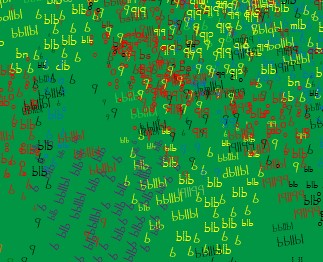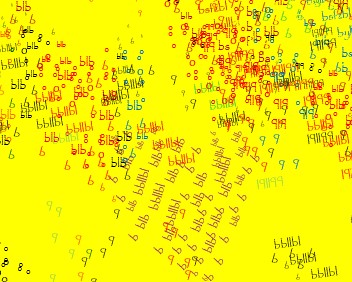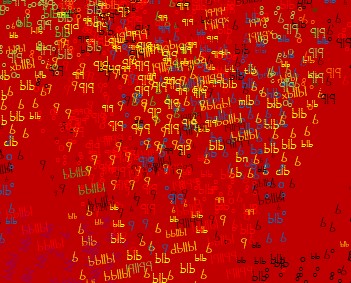Le personnage de cette fiction avance à nu. Sur la table même de la librairie où il attend, dès la quatrième de couverture, il s’adresse directement à toi, lecteur, qui vient de le prendre en main, cherche à te séduire, à te convaincre, non s’il te plaît ne me repose pas, j’ai écrit quelque chose spécialement à ton attention, en première page, va voir : ce livre, puisqu’autobiographie d’un livre il y a, t’emmène d’emblée dans son univers, te prend par la main de peur que tu ne la lâches (ici aussi la concurrence est rude). Puis il te raconte sa vie au camp (la librairie, mais cet endroit est pour lui l’antichambre du Pilon), sa gestation douloureuse, la manière dont il s’est débarrassé de son ombre (son auteur) pour en chercher une autre et au final devenir un des pseudonymes (hétéronymes devrais-je dire…) d’un des auteurs européens les plus célèbres (ce qui nous vaudra une poursuite mémorable dans Lisbonne).
C’est un livre court, de ces opuscules qui se posent à côté de la caisse et qui cartonnent, partent comme des petits pains, de ceux qui se lisent en une heure, peut-être deux, mais qui donnent le vertige, et qu’on relit pour la jubilation qu’ils procurent.
Autobiographie d’un livre : c’est une promesse tenue et un paradoxe. Comment ce livre qui est en train de s’écrire peut-il donc prendre la parole ? Le personnage de cette fiction, très joueur, joue de cet intervalle, et de ce paradoxe. Au final, c’est une histoire d’amour – et cette expression n’est pas vaine – qui se noue au fil des pages entre toi, lecteur, et lui-même (parce que moi, je n’y suis plus pour rien depuis longtemps).








Quatrième de couverture :
Tu viens tout juste de m’apercevoir, là, bien en évidence, Autobiographie d’un livre, voilà un titre accrocheur, et intrigant, alors tu m’as empoigné, bon Dieu que c’était bon, et puis tu m’as retourné, comme on retourne une carte, un sablier, ou bien quelqu’un sur le grill, afin de la lire, cette quatrième de couv’. Je sens maintenant comme au creux de mes reins la légère pression de ton pouce sur mon dos, ma couverture posée au creux de ta paume, tes doigts, vibrillonnant de cette énergie positive qui te caractérise.
Peux-tu attendre encore un instant ? Ne me repose pas, s’il te plaît. Tu n’as pas idée de ce que je vis ici. Accorde-toi un peu de ton temps – le temps de te convaincre, d’éveiller ton désir. N’hésite pas même à t’adosser à un mur, à t’accroupir même, si toutefois tu l’oses, pour te concentrer. Puis rends-toi directement à la première page, tu pourras y lire un billet que j’ai rédigé spécialement à ton attention.
Extrait :
C’est à l’instant où ils déboulent de la rua d’Estrella pour arriver à la basilique qu’Al, debout dans le tram qui s’apprête à repartir, les aperçoit à une vingtaine de mètres derrière lui. Un type à la gabardine jaune attend à l’arrêt. Il a loupé le tram. Al lui adresse un signe de la main, qu’il ne comprend pas. Tous deux observent la malle décrire en guise de virage un superbe arc-de-cercle, manquant pourtant de peu de se renverser. Elle hoquette une dernière fois puis s’arrête, presque au cul du tram qui lui n’en finit pas de repartir. L’inconnu descend, pousse légèrement la malle, parvient à sauter sur le marchepied, attrape d’une main la boule d’attelage, tire la malle d’un coup sec pour l’y accrocher. C’est à cet instant que, tout essoufflé, j’arrive. Je regarde, médusé, le tram s’éloigner, Al à son bord, qui regarde derrière moi. Quand je me retourne, le type à la gabardine a disparu. Il n’y a plus que Rico, qui les mains sur la hanche, affiche une moue de connaisseur, qui elle semble murmurer : beau boulot.
– C’était qui le type avec la Berlu ? lui demandé-je.
– Pepe Carvalho.
– Merde. Le Pepe Carvalho de Charo et de Biscuter ?
– Lui-même
– Fuck. Il n’a pas perdu la main dis donc.
– Toujours sur le pont le vieux fumier.
– Bon on fait quoi du coup ? On court ?
Rico rigole : non, il ne court pas. Il n’a jamais couru. Comme je viens de m’offrir un sprint, nous regardons ensemble le tram devenir au loin un bavarois à la mangue et à la passion puis un petit bonbon au citron bientôt avalé et digéré par le crépuscule. Rico fouille alors dans la poche de son manteau, en sort un smartphone, tapote des deux pouces et à toute vitesse sur l’écran, puis patiente un instant avant de lever la tête vers moi :
– On passe les prendre devant l’Assemblée Nationale.
– Qui les ?
– Ab et Bédo.
Deux minutes plus tard, nous distinguons leur silhouette. Ab sort une flasque et boit au goulot une large rasade.
– Vous les avez vu passer ?
– Non, répond Ab, tout en s’essuyant la bouche du revers de sa manche. Pas l’ombre d’un Ziber, ajoute Bédo.
– On fait quoi en attendant ?
– On avise, me répond Rico.
On commence aussi à marcher vers le Bairro Alto, où nous espérons retrouver le reste de la bande. La ville semble alors comme un somnambule qui traverse l’Histoire les bras ballants. Sur le Largo de Camoes, seule une meute de pigeons chie sur la statue du grand poète. Nous filons vers le Largo do Chiado avant de nous enfiler dans la rua Garrett. La librairie Bertrand est la plus vieille de Lisbonne, me dit Bédo. Elle est ouverte depuis 1732, précise Ab. En vitrine, quelques fantômes donnent le change (mais nous ne sommes évidemment pas dupes). Les rues sont toujours désertes. Seuls roulent quelques taxis. Même la gare qui ne dort jamais semble dormir à points (de ventes) fermés. Bédo chantonne à mi-voix pour lui seul. Les nuages flottent. Je cherche la lune – c’est peut-être Bédo, il semble complètement perché, qui l’a volée.
– Je ne vois plus la lune… ?
– Marre de la lune, me répond Bédo. Ouais, on a tué la lune, ajoute Ab.
Et puis dans le silence, de toutes les fenêtres nous arrivent des hurlements, et de celle la plus proche un cri étrange – Gooooooool !
– Qu’est-ce qui se passe ? Un attentat ?
– Non. Benfica a marqué.
– Benfica ?
– C’est pour ça que les rues sont désertes. Benfica joue ce soir en coupe d’Europe contre l’Ajax.
– Eusebio joue ?
– Eusebio ne joue plus depuis cinquante ans Bédo. Et Cruyff ne joue pas non plus.
– Ah.