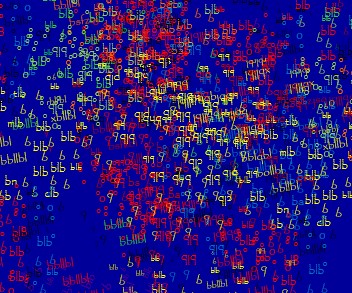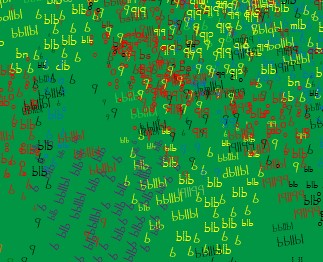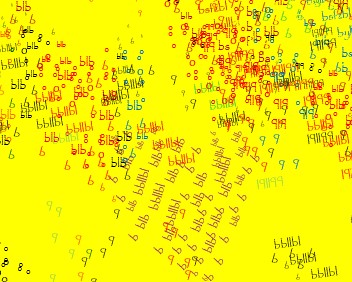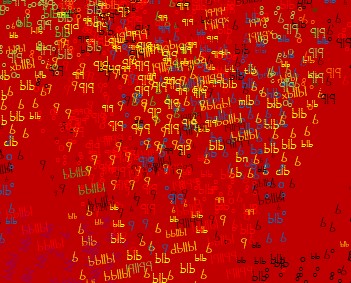C’est l’histoire d’une jeune femme, Viviane, peintre et art-thérapeute, qui se voit soudainement confronter à la perte.
Elle habite en compagnie de son frère, Katz, dans un immeuble situé dans un cul-de-sac, qui par métonymie lui a donné son nom, la Semaise. C’est un lieu chaleureux où l’entraide est de mise, et l’anonymat pas vraiment la règle. Un jour, son frère disparaît. Accompagnée des résidents de la Semaise, elle bat les montagnes alentour et la vallée, encore enneigées, pour le retrouver. En vain. Une fois épuisées toutes les possibilités de recherche, résignée, elle se réfugie dans son travail artistique, tentant de surmonter l’absence de Katz, avec qui elle formait un couple singulier, celui d’orphelins qui ont avancé dans la vie soudés et entretissés. Le quotidien et la pratique artistique de Viviane s’effilochent peu à peu, jusqu’à son équilibre mental qui finit par vaciller…
Des dizaines de personnes disparaissent ainsi chaque année sans laisser de trace. Comment vivre alors pour leurs proches avec cette perte, probable mais incertaine, qui laisse tout en suspens ? Parviennent-ils tous, dénués de certitude, à affronter le vide, à surmonter l’absence de l’être proche ? Peuvent-ils, en l’absence également de toute preuve, de toute trace, en faire le deuil ?






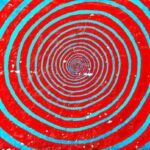

Extrait :
En fin d’après-midi, elle mit de la musique, se posa pour fumer une cigarette, boire la tasse de thé qu’elle venait de préparer, se promettant ensuite d’apporter un peu d’ordre à son intérieur, qui était sens dessus dessous. C’est à l’instant précis où elle donnait un coup de langue sur sa feuille de cigarette qu’elle entendit un ricanement, dans sa tête, derrière elle, elle ne sut dire, un ricanement qui résonne, se réverbère, à la fois unique et multiple, mille rires fondus en un, à plusieurs épaisseurs, un ricanement qui se prolonge et prend tout l’espace, au point de vous faire vaciller. Elle sursauta. Sa tasse tomba. Elle se figea un instant puis se retourna.
Des milliers de petits êtres, adossés à la plinthe, ricanaient en la regardant, de minuscules fourches à la main. Des milliers de petits-êtres en ordre de bataille, prêts à donner l’assaut. Elle eut alors un sursaut, une réaction de défense extraordinaires. Une rage salvatrice la prit et la déborda. Elle hurla. Un cri emplit l’espace, rebondit contre les murs et contre les petits êtres. Elle les vit s’enfuir, cavaler sur les murs, se faufiler derrière les armoires, dans les prises électriques et disparaître dans les murs. Elle courut chercher la hache, puis la masse qui reposait dans un coin de l’atelier, pour défoncer le mur. C’était un mur porteur, elle ne réussit qu’à l’égratigner.
Elle courut à la quincaillerie acheter un textile imperméable, sorte de bâche hermétique qu’elle n’avait qu’à dérouler et à scotcher. Elle passa la fin d’après-midi, haletante, à en revêtir les murs. Elle colla du chatterton sur les prises et à la sortie des tuyaux, démonta toutes les plinthes, qui n’étaient que des caches misères, puis boucha tous les interstices avec des lamelles de chiffon. Ils ne passeraient plus, ne pouvaient plus passer. Elle appela le menuisier et lui commanda des volets pleins – c’était jeudi, non il ne pourrait pas passer le lendemain mais sans faute le mardi suivant pour vérifier les cotes qu’elle lui avait données – puis débrancha le téléphone, ils pouvaient aussi passer par là.
Elle attendit ; dix heures passèrent, bientôt onze. Elle entendait leurs voix, bien lointaines, leurs voix qui sortaient des murs, mais ils ne sortaient pas, désormais prisonniers. Tout était hermétique, le sacrifice de la-Bruyère n’avait pas été vain.
Minuit venu, elle s’installa sur son rocking-chair et se balança tout en écoutant ce qui lui disait cette nuit. Ils ne viendraient plus. Le mur restait blanc, sans aucune trace d’activité. Les grains du crépi semblables à des grains de lumière, à des œufs, ne bougeaient pas. Les voix se faisaient plus lointaines encore, étouffées, dans quelques minutes mortes peut-être. Elle pensa que c’était peut-être un piège, resta aux aguets. Il ne se passa rien. Son angoisse reflua. Elle se fit du thé, s’installa, s’amusa à dessiner avec sa cigarette des ronds de fumée. Elle était rassurée par la décision qu’elle avait prise. Elle s’en était débarrassée. Ils ne viendraient plus. Le mur et le textile qui le recouvrait étaient vierges de leur présence. Tout était hermétique, le sacrifice n’avait pas été en vain.
La nuit passa ainsi. L’excitation était si grande qu’elle ne songea pas à dormir. Elle voyait sous le textile les grains du crépi, chaque grain était un œuf – elle pensa aux tortues qui pondent sur la plage où elles sont nées, puis repartent en laissant leurs œufs. Elle les avait étouffés, ils n’écloraient pas. Pour plus de sûreté, elle ôta un instant le textile, excisa chacun d’eux avec son couteau, puis le remit soigneusement. Cela lui prit deux bonnes heures. Après quoi, elle se remit dans son fauteuil, se balança en fumant et en buvant du thé. Elle entendit les premiers bruits dans la rue, une moto, les éboueurs qui passaient. L’aube se dessinerait sous peu. Elle finit sa tasse de thé, la remplit de nouveau, se roula une cigarette. Elle eut à cet instant un sentiment étrange, elle ne savait quoi, quelque chose qui l’agaçait, la dérangeait même, le sentiment que son regard était comme borné, son champ de vision coupé en périphérie. Elle ne sursauta pas, ne sut pas sur l’instant ce qui se passait. C’était juste une impression qui persista, comme si une tache noire, impossible à localiser, venait obturer, obscurcir en périphérie son regard.
Ça dura quelques secondes. Elle cligne alors des yeux, se presse les paupières avec les doigts, elle est fatiguée, se jette en avant pour soupirer et se détendre la nuque, les yeux mi-clos, puis s’étire. Une tache noire, une immense tache noire passe à cet instant devant ses yeux, qu’elle ouvre grands. Le plafond est noir, entièrement recouvert de petits êtres habillés de noir, qui l’observent en silence, sans ricaner, à peine narquois ; des milliers de petits êtres qui ont tous la gueule de Katz ; mille petits Katz qui la dévisagent. Elle a un sentiment très étrange, comme d’une plongée, d’un écrasement, comme si ce plafond allait lui tomber sur la tête. C’est au moment où tous les petits-êtres se laissent tomber sur elle qu’elle perd tout à fait pied.
Elle ne sent alors plus rien, rien que sa tête qui tournoie, sa tête qui comme un avion touché tombe tombe, tombe encore, comme une pierre au fond de la mer.
Elle ne hurle pas, reste immobile, se fige tout à fait, par l’intérieur, la glace progressant de son cœur même pour s’étendre au reste de son corps, tandis qu’ils l’escaladent sans hâte, pour entrer dans son corps par tous les orifices.
Ce fut, me dit-elle des mois plus tard, comme un viol – un viol physique et mental.
Elle ne fit plus rien pour se protéger. Ils entraient, couraient, sautaient, s’amusaient à se poursuivre, sortaient, rentraient de nouveau, comme dans une maison abandonnée, un moulin qui ne donnait plus de grain à moudre.
Après, elle ne sait plus. Le barrage lâcha. Elle rompit tout contact. Elle ne fut plus là, ni ailleurs. Nulle part sans doute : c’est bien là la folie.