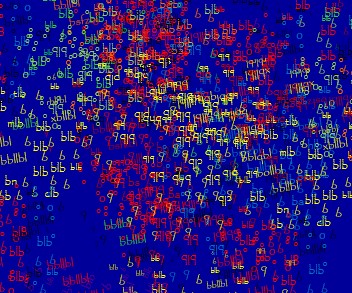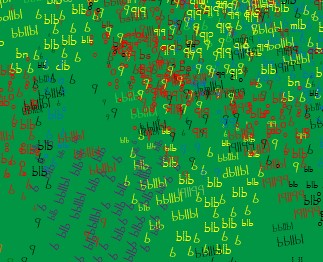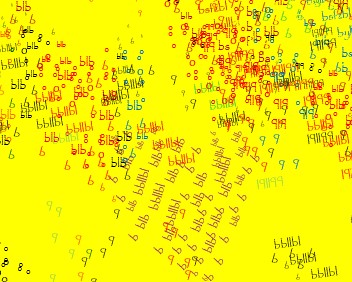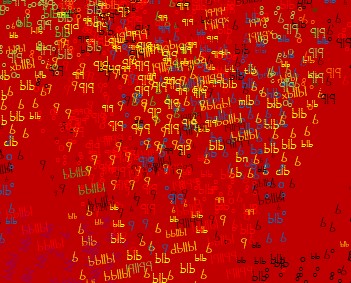Très peu de textos ou de fils twitter, pas de bruit de fond urbain dans ce roman, puisqu’il se déroule pour l’essentiel dans une ville abandonnée à la suite d’un accident nucléaire. Plus de dix ans après, Laura revient dans la Zone dans le but peut-être de trouver un but à son existence, ravagée par la catastrophe. Dans une suite de lettres à une amie, elle évoque son passé, ses blessures et ce retour dans sa ville natale, devenue une ville fantôme, qui donne lieu à des rencontres susceptibles de modifier le cours de sa vie.
Cette fiction dessine la trajectoire d’une femme confrontée à une question cruciale : comment va-t-elle pouvoir continuer à vivre ? Le chemin qu’elle se fraie pour y répondre est sinueux et étroit, et nous mène à une fin à la fois attendue et surprenante, où s’élève une multitude de voix de femmes, qui en fait à mon sens un texte engagé.
EdN comme :
l’Encyclopédie des Nuisances (maison d’édition qui publiait des textes de critique sociale dans une optique anti-industrielle),
ADN (cet ADN des plantes modifié par les radiations),
et aussi comme End : happy end or not happy end ?
L’idée de cette fiction m’est venue en lisant La Supplication de Svetlana Alexievitch (prix Nobel de littérature 2015). Dans ce texte publié en français en 1999, grâce à sa patience et sa faculté d’écoute (elle laisse advenir ce qui ne se dit qu’une fois que tout a été dit, au terme de longs entretiens), grâce aussi à un sens subtil et éprouvé de la composition, l’écrivaine biélorusse a construit une forme polyphonique. Son récit est un écrin pour chacun des témoignages de ces survivants. On y entend la douleur à nu, une parole sans voile, qui atteint l’os même de cette douleur.
Plusieurs points d’ancrage m’ont aidé à bâtir peu à peu une trame narrative, qui m’a permis de me dégager de l’impression et l’empreinte que m’a laissées ce texte : un lieu d’abord, cette ville fantôme qui s’est aussitôt présentée à mon esprit et que j’ai peu à peu imaginée, dessinée, peuplée, d’hommes, de femmes, de morts, d’histoires. Avec constamment, en toile de fond, cette hypothèse : si ça arrivait en France ?
J’ai ensuite dessiné la trajectoire de Laura en l’imaginant avant la catastrophe comme une femme libre, une artiste engagée et cultivée. Dès lors, comment continuer à vivre ? Accepterait-elle de survivre ?
J’ai enfin (mais plus tardivement, ce ne fut pas pour moi un embrayeur) été sensible à ces endroits du monde, condamnés aux hommes parce qu’encore hautement radioactifs, et paradoxalement devenus des réserves naturelles : plus de trente ans après l’explosion de la centrale de Tchernobyl, la zone, d’un rayon de trente km, abrite une vie sauvage d’une diversité et d’une richesse étonnantes. Si les espèces qui dépendent des hommes et de leurs déchets (corneilles, rats, pigeons etc.) ont disparu, on peut en revanche y apercevoir des loutres, des aigles, des ours, des lynx (et bien d’autres espèces), qui ont trouvé là un territoire assez large pour l’habiter, sans gêne, loin des hommes.








Extrait :
J’ai parcouru les quatre cent kilomètres jusqu’à Biguetonne sans me presser, avec ce sentiment que devant moi s’ouvrait une nouvelle vie. Plus j’avançais, plus ma décision se dégonflait pour se fortifier, plus le poids qui m’entravait levait sa pression.
J’ai fait quelques courses (et un saut jusqu’au cimetière), baguenaudé un moment dans le centre-ville, avant de trouver un hôtel pour la nuit, à proximité de la Zone. Un hôtel borgne, mais bien vivant, dont les cloisons (le terme « murs » semble inapproprié, parlons plutôt de papier bible) n’arrêtaient aucun bruit. Mais ma chambre donnait sur la Muraille.
On s’imagine, comme jadis derrière une de ces enceintes qui marquaient et signifiaient la fin de la ville, qu’il y a des prés, des routes, des bois. Rien de tout ça : c’est le même tissu urbain, mais délaissé, déchiré, pillé.
A croire que cette déshérence a peu à peu grignoté ce quartier, autrefois branché, et qui ne compte plus aujourd’hui que des hôtels de passe, des échoppes délivrant de la street food, des boutiques vides et sombres où bricolent des revendeurs de toutes sortes. On peut aussi y trouver un passeur, prêt à vous faire visiter la Zone pour la journée.
Cette Muraille est un épouvantail. Les abords de la Zone sont un refuge pour toutes sortes de marginaux ou de délaissés qui y trouvent la tranquillité, un dernier objet qu’ils pourraient y arracher, ou simplement un toit, un abri pour dormir (on y trouve aussi, parait-il, des cadavres abandonnés).
Le lendemain matin, je n’ai pas même eu à montrer patte blanche au poste de contrôle.
Il m’a simplement suffi de dire aux deux jeunes militaires en faction que je souhaitais me rendre au cimetière pour honorer mes morts.
J’ai franchi le poste de contrôle, animée d’une frénésie quasi incontrôlable, retenant à peine mon envie de crier, de foncer devant moi, avec la sensation exaltante de me dévêtir (de me délester même) d’un manteau mangé aux mites, qui ne m’allait plus depuis trop longtemps.
Trois cent mètres plus loin, je me suis arrêtée pour attraper et déplier ma vieille carte routière. Je me suis retournée : la Muraille avait l’air de ce côté de l’ultime survivance d’une civilisation perdue.
Au fur et à mesure que l’on s’en éloigne, la présence humaine se raréfie.
J’ai traversé les faubourgs abandonnés de Biguetonne sans y trouver âme qui vive, avant de m’engager sur les routes de campagne.
Ça a tout l’air d’une réserve, et c’est l’envers d’une réserve. Les routes sont défoncées, pleines de nids-de-poule, de touffes d’herbes et jonchées d’objets divers. J’ai traversé des villages abandonnés, des zones industrielles désertes, recouvertes de publicités désuètes, roulant à vitesse modérée pour pouvoir observer à droite, à gauche.
J’ai vu un chevreuil et un blaireau s’enfuir à mon approche, évité trois hérissons, admiré une bande d’aigrettes et un faucon s’envoler, aperçu enfin deux silhouettes humaines se découper au loin dans le paysage.
Au bout d’une heure de route, au loin s’est profilée ma ville natale, Bornes, qui avait tout l’air d’un mirage.
Je suis entrée par le sud et ses nouveaux quartiers.
Première impression de formidable et extrême neutralité, comme d’entrer dans une de ces images de synthèse destinées à la vente d’un programme immobilier – image oubliée sur un 4 par 3, lavée, salie, blanchie par le soleil et les intempéries. Avenues mornes et sans arbres. Béton, verre, inox, façades grises blanches, asphalte anthracite. Je me suis demandé comment on avait pu créer et habiter des villes aussi lisses, dénuées à ce point d’aspérités et de recoins. La vie était partie avec ses couleurs.
Puis, en empruntant l’artère centrale qu’est l’avenue Mandela, j’ai eu ce même sentiment qu’ont dû ressentir autrefois des chefs de guerre en entrant dans une ville vaincue.
Le parc aux Buttes n’est plus qu’un ballon chauve. Il a été rasé.
Le dôme de l’église orthodoxe a en partie perdu ses feuilles d’or – volées sans doute.
La cité des Millimes, avec ses barres désertes, toutes ses fenêtres qui semblent comme autant de petites bouches d’ombre, ses squelettes de voiture rouillés, m’a malgré tout paru familière.
L’étrangeté venait d’ailleurs. Je n’avais pas l’impression de revenir d’un long voyage.
Je reconnaissais tout et je ne reconnaissais plus rien. J’avançais au ralenti, les fenêtres ouvertes.
Je me serais presque attendue, que d’un baiser ou d’une simple pression sur le bouton lecture, la vie reprenne son cours, arrêté un jour subitement.
Pas de panache aux cheminées de l’usine de recyclage. Pas de vagues ni de trafic d’aucune sorte sur le Lendou – des façades inanimées qui dominent un cimetière de péniches et de bateaux, au milieu duquel déambulaient des canards qui slalomaient entre les détritus.
C’est l’absence de lumière qui est le plus déroutant : une ville morte aujourd’hui se reconnaît à ça, à ses enseignes et ses façades qui ne clignotent plus, à ses bouches froides et noires et à ses écrans inertes.
Je pensais que l’émotion grandirait au fur et à mesure que je me rapprocherai de la maison. J’ai peut-être eu le sentiment de me vider (comme une baudruche qui se dégonfle !), c’est tout. Pas d’échos de voix perdues ou de souvenirs si vivaces qu’ils vous débordent.
La porte ne baillait pas. Il n’y avait plus de porte – sursaut, début de panique : simple réflexe. Je savais que de nombreuses maisons de la Zone avaient été vidées.
Il ne restait plus grand-chose dans les pièces. Une commode IKEA® (qui s’écroulera si on la déplace), la maie (son fond, quasi amovible, la rend quasi impropre à la vente) remplie de bricoles, et le lit de ma grand-mère (indémontable si on n’en connaît pas le modèle de charnières). Porte, fenêtres et persiennes ont été enlevées. On est pour ainsi dire de plain-pied sur le jardin, tout à fait retourné à l’état de friche.
Voilà maintenant trois jours que je vis ici.
A mon arrivée, le silence ressemblait au vent, au vent qui balaie tout et qui avec le temps a raison de tout.
J’ai pensé aux premiers âges de la terre, avant que la vie n’émerge, où il n’y avait rien que le ciel et l’eau, entre-deux le vent qui venait dessiner des ondes sur cette soupe primitive. Je pensais ne jamais entendre ce silence, mais c’est faux, c’était juste une idée dramatique, grandiloquente – conception lyrique de la vie (le lyrisme, je l’aime en basse continue, sec et coloré). C’est le même silence que dans les campagnes. Nous sommes tellement habitués au bruit de nos villes que nous oublions qu’avant les machines – il n’y a pas si longtemps, du temps de nos arrière-grands-mères – le monde était silencieux.
C’est juste calme. Comme une ville la nuit qui serait tout à fait endormie.
Le silence ne bourdonne pas, il ne plane pas non plus, il n’est pas serein, ni triste, ni profond, et il ne siffle pas (il est parfois si silencieux, paraît-il, qu’il en deviendrait assourdissant…). Il crève doucement, mon silence, n’en finit pas de crever, à la manière d’un chien qui a le train paralysé et qui ne s’arrête plus de baver (oui, c’est vraiment dégueulasse).