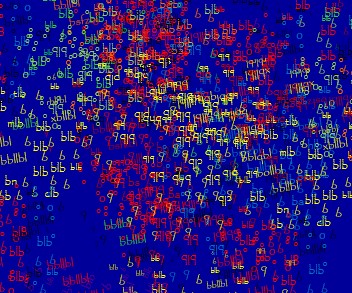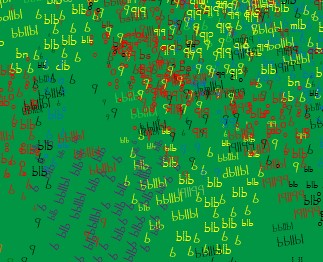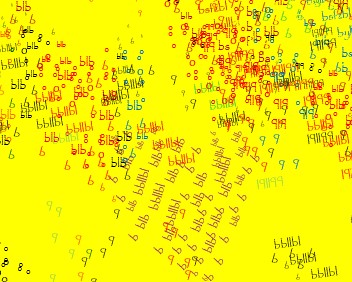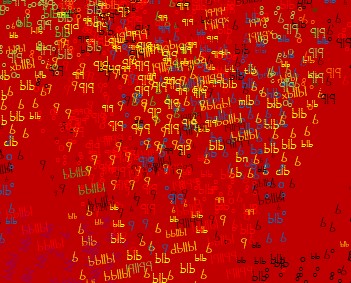Un accident, suivi d’un coma, d’une amnésie partielle et de séquelles dues à des brûlures conséquentes. A travers l’écriture d’un carnet de bord improvisé, ce jeune homme en convalescence dans une institution située au cœur de la Brenne, revient sur son coma et sur son passé, dépecé, pour ainsi dire éparpillé façon puzzle. Il se reconstruit peu à peu et noue également de fortes amitiés, avec des personnes très différentes mais toute singulières à leur manière, qui vont l’aider à refaire surface, à embrasser de nouveau l’espace pour tracer son nouveau chemin dans la vie.
Nouveau monde comme la création et l’ouverture d’un espace mental, pour le narrateur et pour moi-même : il m’a fallu du temps pour mener à bien ce premier roman et mon apprentissage de l’écriture (#momentinoubliable).
Nouveau monde alors que le narrateur fait œuvre d’archéologie ? : la recomposition de la mémoire qu’est la sortie d’une amnésie est en quelque sorte, aussi, une réinvention. Non pas dans les faits eux-mêmes, mais dans la place que l’on donne à chacun deux, dans la manière, nouvelle parfois, de les interpréter, de les percevoir et de les agencer : tout comme un patient le fait lors d’une cure analytique.
Nouveau monde enfin de par l’exil du narrateur : français par sa mère, argentin par son père, il vit à Buenos Aires jusqu’à l’âge de 8 ans. Leur départ précipité puis leur arrivée impromptue à Paris est bel et bien pour le narrateur un changement de vie, d’horizon et d’entourage.
Nouveau monde est sans doute mon roman le plus cher. Il est comme cet enfant difforme et disgracieux qu’on chérit à cause de ses faiblesses et de sa fragilité, mais aussi parce qu’il a demandé plus d’attention, de soins et de patience. Il m’a fallu plus de temps, plus de capacité d’invention et de concentration que pour les romans qui ont suivi. Délaissant progressivement mon activité de chroniqueur littéraire et musical (essentiellement pour le Matricule des Anges et pour Improjazz), je suis, d’une certaine manière, véritablement entré en écriture en… l’écrivant. Ensuite, plus rien n’a été pareil : je m’en savais capable. Je savais aussi quel plaisir, quelle joie c’est, d’écrire, page après page, un roman, de retrouver, jour après jour, des personnages qui trouvent peu à peu leur cohérence propre : un plaisir intense et durable, une joie qui ne vous déborde pas mais vous gonfle la poitrine et élargit votre horizon. Il me semble que je n’ai jamais cessé depuis de chanter, en basse continue certes, mais de chanter : n’ayez aucun doute à ce sujet.







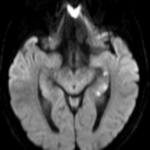
Extrait :
J’attends parfois sur le banc, devant, un peu plus haut. J’attends, équipé d’un journal que j’ouvre dans toute sa largeur, pour éviter qu’on ne me dévisage ; je me démerde pour que ce soit un grand format, pas un format tabloïd, ils ne couvrent rien, peu importe l’édition, souvent la date de péremption est dépassée, l’autre jour je crois même que, noyé par mon appréhension, je le tenais à l’envers. J’ai souvent fait cela, je crois, attendre sur un banc.
Je sens l’air, je le hume, j’essaie de détendre mes muscles maxillaires, de diluer l’angoisse qui me comprime le visage, le tétanise presque. Je fais passer un peu de vent dans ma tête.
Un type vient chaque jour à cette même place, y reste longtemps à ne rien faire – c’est lui qui m’a donné cette idée. Ça ou autre chose. Tout m’est indifférent. Là ou ailleurs, c’est partout pareil. Partout : nulle part. La première fois, c’était maintenant il y a une semaine, je suis sorti juste après son départ, profitant d’une très courte désaffection de l’allée pour m’installer sur mon banc sans être au su et vu de tous. C’est une petite averse qui m’en a chassé. Je ne crains pas la pluie. Mais je n’ai pas d’autre journal que celui-ci – après ça devient du papier mâché : comment m’abriter avec un torchon qui ne tient plus, dégoulinant d’encre et de mauvaise pâte à bois, pour ainsi dire de la bouillie ? Le temps que je me décide à rentrer, l’averse avait presque cessé. Mais, pour une fois, ma décision était prise. Alors, je suis retourné derrière ma fenêtre.
Il me semble que j’ai longtemps été comme ça, à contretemps, à attendre sur un banc, un tabouret, à regarder mes pieds, mes chaussures, à espérer qu’ils me mènent quelque part, à prendre des heures à me décider – je comptais trop sur eux peut-être.
Le type sur ce banc, je ne le vois jamais arriver rarement partir (l’autre jour, c’était autre chose : je guettais) – il y reste bien trois quatre heures dans la journée, alors je n’ai très vite plus fait attention. Quand le banc est libre, je m’y installe. Hier, il est arrivé au moment où je venais de me poser. Il a dit : C’est mon banc, d’habitude c’est mon banc. Puis il est resté planté devant moi – je n’avais jamais remarqué (la distance est trompeuse) combien son physique en impose : il doit bien peser son quintal, atteindre les deux mètres sous la toise. Je n’étais pas très à l’aise – la pomme d’Adam coincée, la salive soudain un peu trop statique. Il est resté raide, sans rien dire, en me regardant, sans aménité, sans insistance, mais tout à fait droit, sans même bouger d’un iota, puis il a redit : c’est mon banc, d’habitude c’est mon banc. Il avait l’air manifestement perturbé par ma présence. Moi je ne disais rien, je le regardais du coin de l’œil, planqué derrière mon canard. Il a fini par m’arracher au vol une miette de regard, un regard qui tantôt traînait tantôt fuyait, un regard qui s’efforçait de fixer la page du journal encore grand ouvert, sans toutefois pouvoir rester tout à fait fixe : c’est comme ça qu’il m’a attrapé. Alors, foutu pour foutu, j’ai dit Ah, oui ouuiiii, dans une sorte de bêlement de chèvre… Il n’a rien répondu, avant quelques secondes plus tard – je ne m’attendais pas du tout à ça, d’ajouter d’une traite, calmement : Reste – mais c’est mon banc d’habitude c’est mon banc. Il est venu s’asseoir à côté de moi. Je me suis poussé un peu. Il avait juste la place pour y caler sa carcasse encombrante. Il a dû sentir qu’il me gênait – sa politesse, je l’ai constaté depuis, est exemplaire. Alors, il m’a mis à l’aise. Il a suspendu ses jambes en travers de l’accoudoir puis s’est allongé sur le banc jusqu’à poser sa tête sur mes genoux et nous sommes restés comme ça, comme deux vieux frangins, silencieux, à regarder les nuages passer dans le ciel. Mon journal, lui, traînait dans la boue, à côté du banc.
C’est comme ça que nous avons fait connaissance, Cumulus et moi.
Je ne connais pas son nom mais tout le monde l’appelle Cumulus. Alors je l’appellerai Cumulus. C’est un nom qui lui va bien. Il a une tête de nuage blanc esseulé dans un ciel pur. Un ciel de Sibérie, oui, comme l’anticyclone. Un nuage léger et clairsemé et en dessous, quelques herbes sporadiques sur la steppe, gelée, avec un berger, ou un chasseur qui, sur un cheval, de type kirghiz, ni majestueux ni bourrin, fin, solide et monté à cru, renifle sous le vent. Mais ce n’est pas exactement pour cette raison qu’on l’appelle ainsi.
C’est mon premier contact ici.